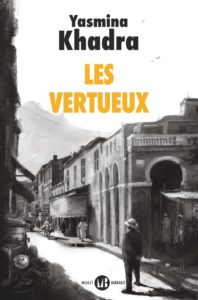
En 1914, Yacine Chéraga est enrôlé malgré lui dans l’armée française pour participer à la Première Guerre mondiale. Ce jour-là, il est arraché à sa famille, ainsi qu’à son petit douar algérien, si petit et isolé qu’il n’a “même pas de nom”. Devenu tirailleur du jour au lendemain, Yacine se fait des frères d’armes, Sid Tami et Zorg. S’il échappe à l’horreur de la guerre, il n’échappera pas à celle des hommes.
Roman d’apprentissage, Les vertueux met en scène un héros intransigeant sur son humanité, qui fait la lente découverte de la violence du monde moderne. “C’est mon meilleur livre”, a fièrement déclaré Yasmina Khadra, face à une salle comble à l’Institut du Monde Arabe ce 12 novembre. L’écrivain algérien — de son vrai nom Mohammed Moulessehoul —, qui a notamment écrit les best-sellers Ce que le jour doit à la nuit, L’attentat ou encore Les hirondelles de Kaboul, se raconte dans nos colonnes.
TelQuel : Yacine, le protagoniste de ce roman, est un homme qui ne voit pas le mal. Tout au long des 540 pages de ce roman, il est confronté à des péripéties, mais endure aussi souffrances et injustices. Peut-on le qualifier de martyr ?
Yasmina Khadra : Yacine Chéraga n’est pas un martyr. Il est la victime expiatoire d’une époque tourmentée, un être dépourvu de tout, spolié, manipulé, livré corps et âme aux vicissitudes de son hypothétique existence. Élevé dans la droiture et la piété, Yacine est d’une candeur et d’une loyauté pas toujours heureuses dans un monde de proies faciles et de mâles dominants. Je ne l’ai pas accablé par perversion, mais afin qu’il incarne les épreuves et les atrocités que les Algériens ont subies durant la première moitié du XXe siècle.
Avec chaque épreuve, vous semblez tester l’humanité de votre personnage, qui ne la perd jamais. Est-ce finalement la question que nous pose votre roman : à quel point peut-on souffrir tout en conservant notre humanité ?
On n’est pas obligé de souffrir pour évaluer sa part d’humanité. Comme on n’est pas obligé d’être riche pour faire montre de générosité. La souffrance n’est pas une vertu, elle est seulement la preuve de notre fragilité. Parfois, elle nous grise et nous rend plus forts, parfois elle appauvrit notre foi en nous-mêmes et nous réduit à peu de chose.
Yacine a beaucoup souffert, mais il a une philosophie de la vie qui lui fait croire que ce sont les épreuves qui forgent les convictions. La force véritable de sa résilience, il l’a puisée dans ses propres blessures. Yacine a fait de chaque déboire une leçon de vie.
Si le parcours n’est pas le même, on peut retrouver quelques similarités entre votre histoire et celle de Yacine. La ville de Kenadsa, l’expérience de la guerre… Aviez-vous le sentiment de vous raconter en écrivant ce personnage ?
Lorsque je veux me raconter, j’écris une biographie. D’ailleurs, j’en ai écrit quatre pour expliquer à certains sceptiques que la littérature est un don, qu’avoir été soldat n’empêche pas d’être poète, romancier ou encore un bon samaritain.
“Lorsque je veux me raconter, j’écris une biographie. D’ailleurs, j’en ai écrit quatre”
J’ai raconté un chanteur cubain, un souverain libyen, un égaré de Molenbeek, un flic de Tanger, un autre d’Alger, un sicario à Juarez, un offensé irakien, un chirurgien de Tel-Aviv, et aucun de ces personnages ne me raconte… Certes, il y a une part de l’écrivain dans chaque œuvre qu’il commet, mais il ne s’agit aucunement d’un dédoublement de personnalité.
J’aime bien Yacine, ce qui ne m’a pas empêché de vouloir lui botter le derrière tant sa candeur frisait l’inadmissible. C’est un personnage aux antipodes de la personne que je suis, et s’il porte beaucoup de mes valeurs, je ne suis pas près de faire le centième de ses concessions. Je peux pardonner, prendre des risques pour les autres, mais, contrairement à lui, je suis incapable de tendre l’autre joue.
Face à une multitude de personnages complexes, où le bon et le mauvais se confrontent, il est beaucoup question de valeurs dans ce roman : l’amitié, la dignité, la foi, le pardon… Finalement, qu’est-ce qui fait qu’un homme comme Sid Tami est bon malgré ses vices, et qu’un autre, comme Zorg, est mauvais malgré sa générosité ?
Être bon ou mauvais est un caractère propre à chacun. Parfois on l’hérite de ses parents, parfois la vie nous l’impose. Shakespeare disait que celui qui a le pouvoir de faire souffrir et qui s’abstient de l’exercer est un seigneur. Or, il existe des gens sans le moindre pouvoir et qui passent leur temps à pourrir la vie des autres. La nature humaine est ainsi faite. Il est des êtres magiques, pleins de bonté et de bon sens, et des méchants qui ne songent qu’à nuire.
Par ailleurs, ce qui est beau pour certains ne l’est pas forcément pour d’autres. Pour certains, Zorg est mauvais. Pour moi, il ne l’est pas. C’est un personnage brisé, écorché vif, mais qui a choisi de se battre pour son peuple. Certes, il n’a ni la carrure ni la compétence d’un stratège pour soulever des armées, mais il a un trop-plein de dignité, et c’est cette vertu-là qui l’absout de ses méfaits.
Que la guerre se situe au centre d’un roman ou en arrière-plan, elle est constante dans votre œuvre. Les 36 années que vous avez passées dans l’armée ont-elles fait de vous l’écrivain que vous êtes aujourd’hui ?
La guerre est une erreur d’appréciation qui prouve combien les hommes sont stupides et misérables au point de croire qu’il existe des causes plus importantes que leur propre vie, plus précieuses que leurs enfants et plus enivrantes que l’amour.
Quant à mes 36 ans d’armée, ils me permettent de tenir debout contre vents et marées. N’importe quel écrivain traversant ce que je traverse depuis deux décennies ne tiendrait pas le coup. Je dois à l’armée ma force de caractère et la vigilance qui me garde de mes ennemis. Mais ce n’est pas l’armée qui a construit l’écrivain que je suis. Je suis né pour écrire.

J’ai hérité cette vocation de mes ancêtres, les Moulessehoul (que les zaouïas marocaines connaissent très bien), une lignée de poètes et d’érudits. Si j’avais été élevé dans un monastère, ou dans un bagne, dans une maison close ou bien encore dans une écurie, cela n’aurait rien changé du tout : j’aurais fini par devenir écrivain, avec ou sans la bénédiction des étoiles.
Vous écrivez cette phrase au sujet des tirailleurs algériens ayant pris part à la Première Guerre mondiale : “Si nous avons été égaux dans le martyre, l’Histoire ne retiendra que les héros qui l’arrangent.” À l’instar de Yacine, faut-il pardonner à cette Histoire ?
L’Histoire me fait penser à ce rituel obscur au cours duquel on convoque l’esprit des morts. Et dans la convocation de la mémoire, on ne réclame de la lumière sur certains détails que pour jeter de l’ombre sur d’autres vérités. Alors, garder quoi au juste ? Seulement ce qui nous arrange !
L’Histoire a autant de versions que de témoins, et lorsque les témoins ne sont plus là, l’Histoire devient systématiquement la version de celui qui se substitue à eux, notamment l’État. Les événements et les dates seront toujours là, immuables, mais ils se plieront aux interprétations qu’on leur donnera. Exemple : l’émir Abdelkader a combattu durant dix-sept ans l’armée française avant d’être vaincu. Pour les mêmes faits d’armes, les mêmes victoires et les mêmes défaites, certains louent la bravoure de l’émir tandis que d’autres le traitent de traître.
De manière générale, vos romans sont traversés par de grandes et belles histoires d’amour, qui ont séduit et marqué au fil des années un grand nombre de vos lecteurs. Pourriez-vous concevoir d’écrire, un jour, un roman sans romance ?
Je peux écrire ce que je veux, mais je préfère donner libre cours à mon imaginaire à travers une belle histoire, forte, entière, touchante et instructive. Le roman est plus vaste, plus pédagogique et plus utile que l’essai ou le traité philosophique parce qu’il a la possibilité d’aller au plus profond des âmes et des événements et de toucher ainsi à l’indicible.
“Le roman est plus vaste, plus utile que l’essai : il va au plus profond des âmes”
J’ai beaucoup appris sur moi-même à travers les personnages que j’ai créés de toutes pièces ; certains d’entre eux m’ont éveillé à des choses qui m’échappaient totalement. Ainsi, Mika (Le Sel de tous les oublis, ndlr) m’a guéri d’une toxine qui squattait jusqu’à mes plus intimes pensées.
Lorsque la sincérité rejoint la générosité dans un roman, on ne peut que transcender nos angoisses et nos peines pour renouer avec ce qui nous rendrait meilleurs et plus forts. Et cette prouesse, ni l’essai ni le traité ne pourraient la réussir.
Y a-t-il une pensée, une philosophie ou des valeurs, un fil conducteur pour ainsi dire, qui englobe l’ensemble de vos romans ?
Réapprendre à vivre. Je donne à voir et à méditer le désarroi, le chagrin, l’échec, la guerre, le malentendu dans ce qu’ils ont de plus dévastateur, afin d’éveiller le lecteur à la chance qu’il a de ne pas endurer la même galère que mes personnages, souvent dépassés par l’ampleur de leur infortune.
Je me souviens qu’il y a deux décennies à l’université de Rotterdam, lors d’une rencontre autour de mon roman Les Hirondelles de Kaboul, une dame s’est levée dans la salle et m’a dit : “Monsieur Khadra, en sortant de votre livre, je mesure la chance que j’ai d’être née dans un pays libre comme la Hollande.” Le livre sert aussi à ça, à nous rendre compte combien nous sommes chanceux par rapport à d’autres.
Selon vous, Les vertueux est votre meilleur roman. Au-delà des trois années que vous avez passées à l’écrire, qu’est-ce qui le distingue des autres ?
C’est mon chef-d’œuvre à moi, le roman qui m’a permis de franchir un cap. J’ai écrit des romans qui ont intéressé des millions de lecteurs aux quatre coins de la terre, mais Les Vertueux, c’est un autre palier. Il est l’aboutissement de cinquante années d’écriture et de persévérance. L’ensemble des critiques sont, pour la première fois concernant mes œuvres, unanimes dans ce sens.
Vous évoquez également la vertu thérapeutique qu’a eue l’écriture de ce livre. De quelles blessures vous a-t-elle guéri ?
Elle a guéri le doute, le doute qui vous fait redouter tant de préjugés, qui vous rend presque étranger à vous-même, qui chahute vos plus intimes convictions. Les Vertueux l’a explosé en vol comme une bulle de savon. J’ai touché le pouls de mes certitudes.
Autre guérison définitive : je me suis débarrassé de l’idée que l’on peut changer les mentalités et rappeler certaines mauvaises personnes à la raison. Ce n’est plus dans mon programme, désormais. Les Vertueux m’a amené à cette réalité sans concession : on a plus de chance d’apprivoiser un crocodile que de convaincre un imbécile ! Comme j’ai la chance de n’avoir que des êtres de lumière parmi mes lecteurs, je laisse la vallée des ténèbres aux esprits retors.
Vous êtes aujourd’hui l’un des écrivains maghrébins les plus traduits et lus dans le monde. En près de quarante ans d’écriture, qu’est-ce qui continue de vous animer, qui vous pousse à entamer un roman ?
Régaler mon lectorat. Nous avons tellement besoin de nous réconcilier avec ce qui nous enthousiasmait naguère et que les tribulations d’une humanité instable tentent d’étouffer en nous. Le livre nous restitue à nous-mêmes. Lorsque nous lisons, nous nous offrons du bon temps, un temps rien qu’à nous…
Quatre de vos romans ont été adaptés au cinéma. Imaginez-vous aisément un destin similaire à celui-ci ?
La plus belle adaptation d’une œuvre demeure celle que l’imaginaire du lecteur conçoit. Mais, découvrir la même œuvre à travers le prisme d’un réalisateur ou d’un dramaturge peut élargir notre propre spectre. Alors, pourquoi pas ? De toutes les façons, une adaptation, cinématographique ou théâtrale, fidèle ou maladroite, contribue inévitablement à élargir l’audience d’une œuvre écrite. Je serais ravi si Les Vertueux passait à l’écran.




