Nichées au 14e étage d’un immeuble sur le boulevard d’Anfa, à Casablanca, les éditions le Fennec célèbrent aujourd’hui un record marocain de longévité. Si le marché de l’édition n’est plus ce qu’il était dans les années 1990, il n’est pas question pour Layla Chaouni, fondatrice des éditions Le Fennec, d’afficher une mine de découragement, mais plutôt de se tourner vers l’avenir.
De fil en aiguille, elle retrace avec émotion les faits d’armes réalisés par sa maison d’édition en l’espace de 35 ans, évoquant tour à tour Fatema Mernissi, Aïcha Belarbi ou encore Aïcha Chenna, ainsi que tous ceux qui ont marqué son parcours d’éditrice.
TelQuel : Qui étiez-vous en 1987, avant de fonder les éditions Le Fennec ?
Layla Chaouni : Je travaillais à la faculté de droit de Rabat, et m’occupais de la revue de la faculté. Je fréquentais beaucoup d’enseignants, je gérais leurs collaborations ainsi que leurs contributions à la revue, et j’étais naturellement en contact régulier avec l’imprimeur.
Lorsque je me suis installée à Casablanca, ce même imprimeur m’a proposé un travail en tant que correctrice, que j’ai accepté. Je ne m’y suis pas vraiment plu : je voyais des auteurs maltraités, d’autant que cette imprimerie, dont je ne citerai pas le nom, était partisane…
C’est ce qui m’a donné envie de lancer une maison d’édition indépendante, dans laquelle je pourrais assumer chacun de mes choix éditoriaux. C’est comme ça qu’en 1987 ont été créées les éditions Le Fennec, qui fêtent leurs 35 ans cette année.
Y a-t-il une histoire particulière derrière le nom “Le Fennec” ?
À l’époque, les maisons d’édition existantes avaient des noms composés de sigles et d’initiales, comme Eddif… D’autre part, les auteurs avaient encore largement recours à l’autopublication. C’était une pratique très courante, beaucoup plus qu’aujourd’hui. Il y avait les éditions Toubkal, fondées par Mohammed Bennis, qui venaient tout juste de commencer, avec une orientation éditoriale bien particulière, autour des sciences humaines.
En décidant de créer les éditions Le Fennec, je savais deux choses : que je voulais proposer une offre éditoriale qui se distingue, et publier des livres en français et en arabe. Il fallait donc un nom qui fasse sens dans les deux langues… Je me souviens que je pensais à un nom d’arbre, quelque chose comme “le figuier”, mais les deux noms traduits auraient été trop éloignés. C’est comme ça que m’est venue l’idée du fennec : un mot issu de la langue arabe, un symbole de résistance et de longévité…
Avez-vous vécu le lancement de cette maison d’édition comme un défi périlleux ?
À vrai dire, pas du tout. En me lançant dans ce projet, je ne pensais pas le moins du monde à la difficulté du métier. Je crois que si je l’avais fait, je n’aurais pas mené cette aventure à bout. Pour ce qui est des auteurs, les trouver n’a jamais posé de problème. Je bénéficiais d’un large réseau d’intellectuels et chercheurs depuis mon travail à l’université de Rabat, je fréquentais régulièrement des écrivains et enseignants…
“Il fallait proposer les livres qui plaisent aux Marocains. Le roman n’en fait pas partie, du moins pas majoritairement”
Par contre, en créant les éditions Le Fennec, je voulais me spécialiser dans la publication de romans. Une fois sur le terrain, j’ai très vite compris que ce n’était pas possible : il fallait proposer les livres qui plaisent aux Marocains. Le roman n’en fait pas partie, du moins pas majoritairement. Les Marocains aiment surtout les essais.
D’autre part, je me suis rendu compte que les romanciers avaient un certain blocage par rapport aux éditeurs marocains : ils se disaient que si on se faisait éditer au Maroc, cela signifiait qu’on n’avait trouvé personne ailleurs.
C’est ainsi que vous vous mettez à publier des essais, récits et livres collectifs…
Tout à fait. C’est en faisant des livres que j’ai appris à connaître le marché et les attentes du lectorat marocain. Au fil des années, je collaborais avec différents chercheurs et intellectuels, dont le soutien m’a été très cher, afin de créer un ensemble de collections : Femmes et loi au Maghreb, dirigée par Aïcha Belarbi, Femmes et Médias avec Latifa Akherbach, Islam et Humanisme avec Abdou Filali Ansary… Et j’en passe.
“La question de la langue était très importante à l’époque, au vu de la tension qui existait entre intellectuels francisants et arabisants”
L’idée était toujours de réunir des chercheurs et penseurs autour de thématiques qui les intéressent, en leur proposant d’écrire en français ou arabe. La question de la langue était très importante à l’époque, au vu de la tension qui existait entre intellectuels francisants et arabisants : leur donner la possibilité d’écrire dans la langue qu’ils souhaitent était une manière de trouver un terrain d’entente, mais aussi d’œuvrer à une unification du milieu intellectuel.
Toutes nos collections étaient pensées dans l’air du temps, et se situaient souvent en réaction aux images négatives de nous-mêmes que renvoyait l’Occident.
Le premier livre que vous avez publié est Sexe, Idéologie, Islam, de Fatema Mernissi. C’était le début d’une longue aventure entre vous ?

Je m’en souviens comme si c’était hier. Fatema a été l’une des premières à m’encourager dans la création des éditions Le Fennec, et m’a immédiatement suivie lorsque j’étais prête à la publier. À partir de là, elle a été une réelle force motrice dans tous les projets que nous avons entrepris. En plus d’avoir dirigé un ensemble de collections, groupes de travaux et ateliers d’écriture, elle a joué un grand rôle dans la création de la collection poche.
Elle aimait réunir autour d’elles tous ceux et celles qui avaient des choses à dire, et travailler de manière synergique. Elle a toujours été là pour moi et pour Le Fennec. Je crois que c’est ce genre de lien que l’on peut entretenir avec une personne qui fait que je trouve mon métier aussi enrichissant.
Je pense aussi à ma collaboratrice Annie Assou, à Omar Azziman, à Abdou Filali Ansary, à Mahi Binebine, à Youssouf Amine Elalamy… Il y a aussi mes deux fidèles collaboratrices, Badia Amzil et Safaa Ouali, à qui je dois beaucoup. Tous ces gens ont réellement marqué le parcours des éditions Le Fennec.
En parlant de rencontres marquantes, il y a aussi votre collaboration avec la militante Aïcha Ech-Chenna, qui a donné lieu à la publication du célèbre Miseria, que l’on regrette de ne plus trouver en librairie de nos jours…
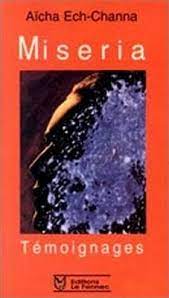
Vous avez raison. Cette rencontre est un moment très fort dans mon évolution, qui est encore une fois lié à Fatema Mernissi. Je pourrais la raconter mille fois. Dans le cadre d’une rencontre de femmes marocaines à l’initiative de Fatema, nous avions invité un ensemble d’associations pour parler de leur travail. Parmi elles, il y avait Solidarité féminine et Aïcha Ech-Chenna, qui racontait le parcours des filles-mères qu’elle accompagnait.
À la fin de la séance, je suis allée la voir pour la féliciter. Je lui ai dit qu’il fallait absolument qu’elle couche tout ça sur du papier, et qu’elle en fasse un livre. Elle m’a répondu : “Je ne suis pas écrivaine, je ne sais pas écrire.” Je lui ai donné un dictaphone en lui demandant d’enregistrer les témoignages de ces femmes, en lui assurant que nous nous chargerions de la retranscription.
C’est comme ça que nous avons collecté les témoignages qui peuplent Miseria… J’ai été absolument dévastée en travaillant sur ces enregistrements. C’était un calvaire d’écouter en boucle des histoires aussi atroces. Par la suite, j’ai mené une série d’entretiens avec Aïcha, de sorte à pouvoir reprendre ses mots à elle dans le livre. Ça me semblait important. Miseria fait partie de ces titres que j’aimerais rééditer à tous les coups, mais on ne peut plus se permettre de faire de gros tirages…
Vous êtes aujourd’hui la seule maison d’édition marocaine à posséder une collection de poche, en proposant des livres à 25 dirhams. Regrettez-vous que d’autres confrères n’en fassent pas de même ?
La création de la collection de poche est venue du constat que lorsqu’on croisait des enseignants et étudiants au SIEL, beaucoup se plaignaient du prix du livre, qui n’était pas abordable pour eux. L’idée était donc de rendre le livre plus accessible. Cette collection a été créée à partir du fonds du Fennec, sans aucune subvention.
J’imaginais que le projet intéresserait d’autres éditeurs, qui accepteraient de nous vendre les droits de leurs livres déjà publiés, afin de proposer une plus grande offre de littérature marocaine à prix réduit… Malheureusement, aucun d’entre eux ne fut intéressé. On a donc commencé à publier des classiques de la littérature française en livre de poche, avec la particularité d’avoir des éditions explicatives adaptées au contexte culturel marocain.
“Ce qui m’a apporté le plus de bonheur dans la vie, c’est la lecture. Je me disais qu’il fallait absolument partager ça”
Le tout premier était La parure, de Guy de Maupassant, au prix de 10 dirhams. Par exemple, en note de bas de page, on avait traduit le mot “calèche” par “cocchi”. C’était un vrai succès, puis les éditeurs du scolaire ont repris l’idée. On a continué à faire du livre de poche, mais autrement.
Ce qui m’a apporté le plus de bonheur dans la vie, c’est la lecture. Je me disais qu’il fallait absolument partager ça. Vous aviez un livre à 15 dirhams : vous pouvez le prendre, le lire, le jeter, le déchirer… Mais vous l’avez. C’était ça, l’esprit de cette collection, que l’on tirait à l’époque à 10.000 exemplaires, pouvant aller jusqu’à trois ou quatre tirages…
N’avez-vous pas l’impression d’avoir assisté à une sorte d’âge d’or du marché de l’édition, qui s’essouffle aujourd’hui ?
Pas du tout. Je continue de recevoir des propositions de manuscrits, avec des textes très différents les uns des autres. J’ai une belle rentrée littéraire en perspective. Ce que je remarque, c’est que les gens écrivent beaucoup plus, ce qui est une bonne chose, mais qu’ils lisent beaucoup moins.
“Ce que je remarque, c’est que les gens écrivent beaucoup plus, ce qui est une bonne chose, mais qu’ils lisent beaucoup moins”
Les gens peuvent critiquer les livres, les auteurs et les couvertures des livres autant qu’ils le souhaitent à coup de billets sur les réseaux sociaux… Pourvu qu’ils les lisent, c’est le plus important. Il y a encore tellement de choses à faire pour notre littérature, d’autant que beaucoup de supports différents sont en train d’émerger. Je pense au livre audio par exemple, qui représente une véritable opportunité.
Contrairement à la majorité, vous semblez très optimiste pour l’avenir du marché du livre marocain…
Absolument. C’est d’ailleurs ce qui me permet de tenir, d’accroître ma curiosité pour les jeunes auteurs, et de toujours vouloir faire plus de choses. Je vois beaucoup d’intérêt pour la bande dessinée par exemple, qui pourrait nous permettre de découvrir de nouveaux talents, mais aussi de mettre au goût du jour de nombreux classiques, comme ça a été fait pour Le pain nu par exemple (aux éditions Alifbata, ndlr) ou encore pour Les voyages d’Ibn Battûta.
Le livre audio m’intéresse énormément. On en avait sorti un en partenariat avec le CCME, j’espère pouvoir en faire d’autres très bientôt. Bien sûr, tout cela demande un investissement, des moyens, et surtout un travail de marketing…
Au bout de 35 ans d’activité, diriez-vous que les éditions Le Fennec ont été le projet de votre vie ?
Oui, et elles continuent de l’être. Je vous avoue que je n’aurais jamais imaginé que cela dure aussi longtemps. À chaque fois que je me sens trop fatiguée et que j’ai envie de jeter l’éponge, je me demande ce que deviendront mes livres et mes auteurs… C’est un souci constant.
J’aimerais réellement pouvoir former des jeunes qui assureront la relève des éditions Le Fennec. C’est important de transmettre et partager tout ce que j’ai appris au fil de ces 35 années. J’aime mon métier d’éditrice, et je continuerai à l’exercer jusqu’au bout. Ce n’est pas fini !




