À Rabat, Nancy Huston nous accueille d’un sourire radieux.
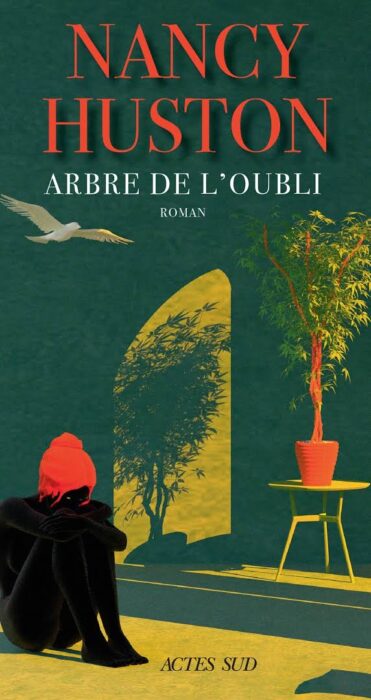
Du haut de ses 67 ans, elle précise de sa voix douce qu’elle n’a pas l’habitude d’accorder d’entretiens lorsqu’elle se trouve en plein processus d’écriture, comme c’est actuellement le cas. Invitée au Salon international de l’édition et du livre (SIEL) dans le cadre de la programmation “Correspondances” de l’Institut français du Maroc, la romancière nous confie ne pas en être à son premier séjour au Maroc.
Quelque temps auparavant, elle se trouvait à Dmina, un petit village aux alentours de Tanger, pour une résidence d’écriture. Difficile, en échangeant avec elle, de se cantonner à un seul de ses livres…
Depuis son tout premier roman, Les variations de Goldberg, sorti en 1981, Nancy Huston a tissé une œuvre déroutante, campée dans les quatre coins du monde, mais dont les personnages se rejoignent souvent dans les souffrances transgénérationnelles qu’ils portent eux, confrontés à l’héritage de sombres épisodes de l’histoire, ainsi qu’à des déchirements personnels qui les dépassent.
Souvent aussi, Nancy Huston fait don à ses personnages de vies tumultueuses, parfois brisées, suggérant une résonance avec son enfance, marquée par le départ de sa mère ainsi que par des déménagements successifs. Pourtant, il s’agit là de similitudes auxquelles on ne saurait réduire la grandeur romanesque d’une écrivaine qui s’efface derrière ses personnages à chaque fois qu’ils viennent à elle, afin d’inspecter au plus près les “lignes de faille” de chacun d’entre eux.
On parle souvent de la profondeur psychologique de vos personnages, et du fait que l’on a du mal à les oublier après avoir refermé vos romans. Comment viennent-ils à vous ? Les étudiez-vous longuement ou, au contraire, s’imposent-ils à vous comme une évidence ?
“Nous sommes tous des personnages de nos propres histoires”
C’est une question que l’on pose encore trop rarement. Les gens ont souvent l’habitude de vouloir associer l’écrivain à son personnage, de chercher en lui un élément autobiographique. Évidemment, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Je pense que l’être humain est prédisposé à recevoir des fictions. Nous sommes tous des personnages de nos propres histoires, de la même manière que nos amis sont des personnages de nos vies.
La construction de personnages me semble être quelque chose d’inné chez les humains, puisque ce processus de création continue dans nos rêves la nuit, par exemple, où surgissent des histoires et personnages souvent invraisemblables.
Peut-être que j’aime tellement écrire des romans parce que les personnages sont des êtres hybrides. Ils viennent de choses qu’on a vues, de nous-mêmes, de souvenirs qu’on peut avoir… Si l’on a de la chance, par un processus très mystérieux, tous ces éléments se cristallisent et quelqu’un se met à exister. On ne demande qu’à y adhérer et qu’à y croire.
Est-ce le cas du roman sur lequel vous travaillez actuellement ?
Pour mon prochain roman, je travaille sur une prostituée trans colombienne. Ce qui me posait problème, c’est qu’elle est très catholique, et que moi, je suis athée. Or, il ne suffit pas d’écrire qu’elle est croyante, il faut véritablement être dans sa tête et dans son dévouement.
A chaque fois que j’ai écrit un personnage, il m’a fallu voyager dans son territoire. Je suis allée dans les sables bitumineux du nord de l’Alberta pour étoffer un personnage du Club des miracles relatifs, je suis allée au Sénégal car un de mes personnages d’Infrarouge avait eu un mari sénégalais…
Là, je me suis rendue en Colombie pour voir où cette femme avait vécu, quand elle était petit garçon, puis adolescent. C’est là que j’ai compris ce que pouvait être la foi : je crois tellement fort en ce personnage qui n’existe pas que j’ai besoin d’aller voir où il a grandi, les églises où il a prié, le fleuve où il a pêché… Et je comprends ce que peut être la foi. Je me fais l’évangéliste de mes personnages.
Cette foi se traduit-elle également dans une proximité avec vos personnages ? Dans plusieurs de vos romans, vous allez même jusqu’à les tutoyer… A quel point vous sentez-vous proche de vos personnages ?
On ne peut pas écrire de façon convaincante si l’on ne se sent pas proche de nos personnages. Quand Flaubert disait “Madame Bovary, c’est moi”, ce n’était pas une coquetterie. Je pense qu’il était très sincère : pour écrire ce roman, il était homme et femme à la fois.
Les questions d’appropriation culturelle sont très complexes, mais quand on souhaite raconter un personnage, il faut absolument pouvoir être un ou une autre. Les histoires des gens qui nous ressemblent sont appauvrissantes. Il est clair qu’on ne peut pas inventer en partant uniquement de l’imaginaire. Il faut se plonger dans la réalité des autres. C’est un processus fascinant et mystérieux, que je ne saurais décrire de manière rationnelle ou scientifique.
Anouk Grinberg a récemment publié un essai formidable, Le Cerveau des comédiens ; elle s’est renseignée auprès des neurologues, entre autres, pour comprendre de quelle manière les personnages existent dans le cerveau des acteurs et actrices qui les incarnent. La plupart de ces découvertes valent aussi pour les auteurs et autrices de romans.

Vous avez cité la Colombie, le Sénégal, le Canada… Il est difficile de vous attendre sur un territoire en particulier, vos personnages sont aussi bien campés aux Etats-Unis, en Allemagne, en France, au Burkina Faso et ils voyagent beaucoup. Cette mobilité est-elle importante pour vous ?
Cette mobilité représente ma vie. J’ai eu une enfance très mouvementée : je n’ai pas grandi dans une ville unique. Le fait de déménager dans mes romans est une façon non pas de poursuivre ce voyage, mais de contrôler ce mouvement qui était très douloureux et perturbant pour moi en tant qu’enfant. En neuf ans de mariage, mes parents ont déménagé 18 fois.
Ce déménagement dans la fiction est ma manière d’assumer ce mouvement comme une richesse. En tant que romancière, cela m’a donné la capacité de me regarder à travers les yeux des autres, et de changer constamment de place.
C’est peut-être aussi ce qui fait la particularité du roman. Car le roman n’est pas né dans des sociétés fermées : il implique la capacité à changer de place et de perspective, tout en imaginant d’autres points de vue. Mon enfance m’a prédestinée à cela.
Dans ce vaste paysage international, que représente l’Afrique en particulier, qui revient beaucoup dans vos romans ?
J’ai visité l’Afrique plusieurs fois avant de véritablement comprendre à quel point l’Occident était coupable vis-à-vis de ce continent.
Arbre de l’oubli (partiellement campé au Burkina Faso, ndlr) est un roman très important pour moi car il m’a permis de me plonger dans un univers inconnu, et d’en constituer toute une bibliothèque. Pour écrire Arbre de l’oubli, j’ai lu tous les grands textes sur l’esclavage, qu’on ne m’avait enseignés nulle part.
Je me suis projetée dans ce personnage de jeune fille métisse, élevée comme si elle était blanche, mais qui n’est pas traitée comme telle et va recevoir des signaux contradictoires quant à son identité. Je pouvais complètement imaginer cette souffrance. Pour ce personnage, le voyage en Afrique est de l’ordre de l’initiation.
“La philosophie africaine connaît l’importance du collectif”
Ce continent, c’est le passé de toute l’humanité, porteur de valeurs que nous avons oubliées. Il y a une Afrique dans nos veines à tous, et que je porte en moi également. Lors du premier confinement, j’ai écrit un recueil de chroniques intitulé Je suis parce que nous sommes : dans ce titre, on retrouve une sagesse très africaine, que l’on ne retrouve pas dans les amphithéâtres de Paris.
Là où les philosophies occidentales ont mis l’accent sur l’individu et l’autonomie, la philosophie africaine connaît l’importance du collectif, et est très consciente de ce que nous devons aux autres. Elle tient compte de cette interdépendance, et je trouve ça très important.
Outre les sombres ancrages historiques de vos romans, tels que l’esclavage ou la Shoah, vous semblez avoir un penchant pour les choses et les personnes brisées, qui dysfonctionnement… Selon vous, le propre d’un romancier est-il d’aller à la recherche de toutes les choses qui ne fonctionnent pas ?
On n’a pas à chercher très loin (rires). Les conflits sont partout dans le monde, sur le plan politique par exemple, mais aussi dans les relations personnelles. Le conflit est non seulement une constante de la vie humaine mais aussi le moteur principal de la littérature et du théâtre, et ce depuis l’Antiquité.
Il y a des livres d’histoire pour raconter les horreurs de la Shoah ou de l’esclavage. Moi, ce qui m’intéresse, c’est de montrer l’intrication des niveaux personnels et politiques, leurs héritages, et d’en tirer des paradoxes.
Imaginez-vous un jour écrire une littérature heureuse, dépourvue des conflits et des douleurs du monde ?
Je ne pense pas que l’harmonie et la tranquillité soient très inspirantes pour un romancier ou une romancière. Ce serait plutôt l’apanage d’un poète. Le roman, par définition, laisse passer du temps. On est inscrit dans un récit : on est forcément engagé dans la tragédie du temps qui passe, tandis que le poème peut se contenter d’un instant unique, détaché des autres, qui peut relever de l’extase et du bonheur absolu.
Pour ma part, je n’ai jamais lu un roman entièrement inscrit dans le bonheur. En lisant La divine comédie de Dante, je me suis dit que le paradis était toujours plus ennuyeux que l’enfer. Et quand les anges jouent de la harpe, leur musique n’est même pas dissonante (rires).
Le rapport à la maternité et à la filiation, qui est lié à votre histoire personnelle, a accompagné la plupart de vos romans. En près de 40 ans d’écriture, sentez-vous une évolution dans la manière dont vous traitez ce sujet si douloureux ?
Il est très difficile de me voir de l’extérieur comme écrivaine. Si je pense à mon dernier roman, la réponse serait non. Il y a toujours une certaine violence dans la filiation. La vie change des choses, mais la personne qui écrit reste la même. Si je suis apaisée, je ne vais pas écrire sur ce sujet. Lorsque j’évoque ce rapport à la maternité, que ce soit de la mère à la fille ou l’inverse, c’est toujours la petite fille en colère qui écrit. L’écriture a été ma manière de tisser quelque chose de solide autour de moi pour tenir le coup.
Etant donné que vous êtes bilingue, vous avez écrit certains de vos romans en anglais, avant de les traduire vous-même vers le français, donnant lieu à des publications originales en français, mais initialement écrites en anglais. Que nous dit ce processus d’écriture des deux langues qui existent en vous ?
Ces deux langues ne sont pas symétriques dans ma façon d’écrire, et elles ne le seront jamais. Je dis souvent que je suis une fausse bilingue, dans la mesure où je n’ai pas parlé le français dans mon enfance. Par conséquent, je ne l’ai pas assimilé de la même manière que l’anglais. Quand j’ai passé quelques mois en Allemagne, j’ai appris la langue allemande, et déjà, je me supportais mieux dans cette identité étrangère que dans celle de la petite fille anglophone abandonnée par sa mère.
Quand je suis arrivée à Paris, à 20 ans, j’ai trouvé beaucoup plus facile d’écrire en français qu’en anglais. Cette langue me semblait ouverte à l’exploration littéraire, pour deux raisons : parce que je n’avais pas vécu mon enfance en français, et parce que je n’avais jamais écrit de dissertation en français.
“À 20 ans, j’ai trouvé beaucoup plus facile d’écrire en français qu’en anglais”
Le milieu intellectuel et militant français dans lequel je me suis retrouvée plongée à cette époque a été très encourageant pour mes premiers pas dans la littérature. Durant ces années-là, j’ai un peu fait semblant d’être une intellectuelle parisienne en bonne et due forme. Heureusement pour moi, j’ai reçu un cadeau empoisonné à cette époque : je suis tombée malade, et j’ai perdu l’usage de mes jambes.
Pendant quelques mois, j’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, et la métaphore qui m’est venue à l’esprit est que j’avais gelé mes racines. C’est là, petit à petit, que j’ai décidé que si je faisais une croix sur ma langue maternelle, j’allais rester une écrivaine intellectuelle, et rien d’autre. Cela aurait pu être épatant, brillant, mais ça n’allait pas prendre les gens aux tripes. Parce que, véritablement, mes tripes sont en anglais. A presque 40 ans, j’ai commencé à écrire dans ma langue maternelle, et ça a changé ma vie.

La question se pose-t-elle encore pour vous aujourd’hui ? Avant de commencer un roman, vous demandez-vous si vous allez le faire en anglais ou en français ?
Bien sûr ! Il y a deux préoccupations que je prends en considération. La première est celle de la langue de mes personnages : Arbre de l’oubli, par exemple, est en anglais car les personnages y sont anglophones. La seconde est celle de la publication.
Or, je n’ai plus d’éditeur en anglais. J’ai une identité d’écrivaine établie à Paris, au Québec, un peu en Afrique du Nord… Dans le monde anglophone, je suis inexistante. Ainsi, ce livre (Arbre de l’oubli, ndlr) que j’ai écrit en anglais, n’a pas été publié en anglais, c’est assez paradoxal.
D’autre part, je n’ai jamais écrit un mot au Canada. Je n’ai pas envie d’écrire des romans français, ni même canadiens. Je me sentirais une imposture si je le faisais. J’ai la nationalité française depuis 40 ans, mais je ne me sens pas française, pas plus que je n’ai envie d’être canadienne ou américaine. Je suis tout ça à la fois, et donc, rien de tout ça.
Pour écrire le roman sur lequel je suis en train de travailler, j’ai pris des cours d’espagnol, car je ne pouvais pas avoir un personnage hispanophone sans connaître la langue qu’il parle. D’ailleurs, pour ce même roman, j’ai aussi fait une résidence d’écriture à Dmina, un petit village à côté de Tanger. J’ai écrit là-bas, mais il est important pour moi que le monde autour de moi disparaisse, afin de laisser place à celui de mes personnages.
Dans vos livres, il y a aussi de la place pour des formes d’écriture qui ne sont pas romanesques, notamment la lettre et le journal qui ont la particularité d’être les lieux privilégiés de l’écriture de l’intime. Ce rapport à l’intimité est-il une de vos préoccupations ?
Je cherche l’intimité, même si je ne cherche pas à exprimer ma propre intimité. Je pense que la présence de ces formes d’écriture vient du fait que j’ai écrit beaucoup de lettres à ma mère après son départ, dès mes cinq ou six ans. Les lettres étaient si importantes pour moi que je suis devenue “femme de lettres” !
Il fallait que je rende ma vie intéressante pour elle, qu’elle m’aime de loin, et donc il fallait apprendre à bien l’écrire. Je crois qu’à partir de là, j’ai pris l’habitude de m’adresser toujours à quelqu’un dans ma tête, et d’imaginer un regard par-dessus mon épaule, qui approuve ce que je suis en train de faire. La lettre implique l’emploi de la deuxième personne, qui m’est beaucoup resté dans l’écriture, comme dans Cantique des plaines. Ça me libère beaucoup.
Diriez-vous que ces lettres, adressées à votre mère, constituent vos premiers pas en littérature ?
Peut-être, oui. Enfant, j’ai commencé à écrire des poèmes, puis des nouvelles au lycée. J’ai toujours su que c’était ce que je voulais faire. Je le disais partout. La vie des écrivains et écrivaines m’a toujours intéressée. Le nombre de grandes écrivaines sans mère est frappant.
La mère est une instance de moralité, et précisément, il faut être amoral pour écrire. Virginia Woolf disait que pour écrire, il faut tuer l’ange du foyer, car elle savait à quel point est meurtrière, pour une femme qui souhaite écrire, l’image de la perfection féminine.
«Arbre de l'oubli»
117 DH
Ou


 Achetez par whatsapp
Achetez par whatsapp

