En 2020, Khalid Lyamlahy codirigeait l’ouvrage universitaire et collectif Abdelkébir Khatibi : Postcolonialism, Transnationalism, and Culture in the Maghreb and Beyond, paru à Liverpool University Press.

Observateur perspicace des transformations qu’a connues le paysage littéraire marocain ces dix dernières années, il est l’une des rares plumes marocaines à s’atteler régulièrement à l’exercice de la critique littéraire dans différents supports spécialisés.
Depuis Chicago, où il enseigne, Khalid Lyamlahy accompagne également l’exportation de la littérature marocaine par-delà nos frontières.
Votre ouvrage le plus récent est un livre collectif sur Abdelkébir Khatibi, l’un des rares auteurs marocains à qui une vraie masse critique et scientifique a été consacrée. Selon vous, pourquoi fascine-t-il autant les universitaires ?
Khatibi est effectivement l’un des penseurs qui continuent d’attirer l’attention des chercheurs et universitaires. Mais tous ses livres ne sont pas logés à la même enseigne. Certains ont reçu plus d’attention que d’autres, tels que La mémoire tatouée, Maghreb pluriel ou encore La blessure du nom propre…
Cette fascination est d’abord liée à son profil : il était à la fois sociologue, écrivain, poète, critique littéraire, philosophe… Il est le modèle par excellence de “l’intellectuel total”, capable de naviguer entre les disciplines.
Par ailleurs, il était régulièrement invité dans le débat public, se saisissait de sujets d’actualité, et était sollicité sur des thématiques très diverses. Il était constamment en dialogue avec d’autres penseurs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis.
Sa pensée et son écriture étaient en mouvement permanent, et c’est ce qui donne autant de matière aux universitaires.

La pluridisciplinarité de Khatibi représente tout de même une exception. Qu’est-ce qui fait que les frontières entre les différentes disciplines littéraires, artistiques et intellectuelles sont aussi opaques ?
Je pense que c’est une question de génération. Celle de Khatibi est composée de figures qui avaient l’habitude, de par leurs parcours, trajectoire et éducation, de lire énormément et d’approfondir leurs lectures. Lorsqu’on lit Khatibi, on se rend immédiatement compte que c’était un excellent lecteur, avant d’être un écrivain de talent.
Cette opacité se traduit lorsqu’on voit que les universitaires spécialisés dans la littérature arabophone connaissent très peu de choses de la littérature francophone, et vice-versa. Ils dialoguent très peu entre eux, et c’est là où le fossé entre les littératures francophone et arabophone est le plus profond.
Il est temps que l’on considère la traduction, qui est une passerelle cruciale, comme un travail de dialogue et de mémoire. On ne pourra pas aller de l’avant sans dépasser la rigidité de cette frontière entre les productions arabophone et francophone.
Pour autant, je ne pense pas que ce manque de pluridisciplinarité soit propre au contexte marocain. Dans les milieux académiques du monde entier, on observe une tendance à la spécialisation, avec des départements universitaires de plus en plus compartimentés.
Si les grands noms de notre littérature sont familiers à l’échelle locale, peut-on tout de même affirmer que notre littérature demeure pour autant méconnue des Marocains ?
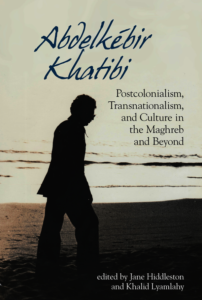
A une échelle globale, il est évident qu’en dehors des cercles académiques, les noms résonnent, mais les œuvres demeurent méconnues. On en revient à la question de l’accessibilité et de l’accompagnement de l’œuvre.
Par exemple, je pense que nous avons un manque terrible de biographies, qui est à l’origine de beaucoup de maux. Nous connaissons très peu nos écrivains, nos artistes et nos penseurs au-delà des œuvres qu’ils ont laissées derrière eux.
Pour reconstituer la trajectoire de Khatibi, les chercheurs n’ont accès qu’aux fragments dispersés dans son œuvre. Les biographies en bonne et due forme sont inexistantes.
Il y a un profond travail de préservation de notre patrimoine littéraire à fournir. Comment faut-il s’y prendre?
Les archives jouent un rôle crucial. Il faut penser la mémoire littéraire de manière globale. J’ai vu que, dernièrement, les médias s’intéressent à nos écrivains du passé, c’est une bonne chose. Toujours est-il que cet intérêt doit se manifester de leur vivant et ça ne passera pas que par l’écrit.
“Un biopic sur Fatima Mernissi sortira bientôt en salle : c’est une démarche extrêmement intéressante, qu’il faut à tout prix encourager”
Un biopic sur Fatima Mernissi sortira bientôt en salle : c’est une démarche extrêmement intéressante, qu’il faut à tout prix encourager. Il faut promouvoir tous les moyens qui nous permettent de continuer à dialoguer avec les auteurs qui ont marqué notre histoire. Ensuite, je pense qu’il y a aussi un travail de vulgarisation et de transmission à fournir, et que nous autres universitaires avons un rôle en ce sens.
Vous publiez régulièrement des critiques littéraires sur différents supports spécialisés tels que “En attendant Nadeau”, ou encore “Zone Critique”. Concevez-vous la critique littéraire comme le prolongement de la chaîne éditoriale ?
La critique littéraire dans des sites et magazines spécialisés a remplacé celle que l’on trouvait dans des revues telles que Lamalif, Souffles ou encore Al-Thaqafa al-Jadida… Pour produire une critique littéraire rigoureuse, qui aborde l’œuvre dans ses différentes facettes, il faut du temps et de l’effort.
Je conçois la critique littéraire comme un acte de reconnaissance et de générosité. C’est une manière de reconnaître l’effort qu’a mis un écrivain dans la conception de son livre, et de mettre en lumière des aspects de l’œuvre que le lecteur ou même l’auteur n’a pas relevés.
Le critique redonne vie et prolonge le dialogue avec le texte. Or, c’est un processus très long, qui ne colle pas toujours avec l’actualité. Nous vivons une période où il y a de plus en plus de publications, mais moins de personnes qui lisent. De nos jours, le cycle de vie d’un livre est très court, et c’est regrettable.
Si nos thématiques sont souvent communes, les auteurs algériens sont plus nombreux, et l’histoire de leur littérature peut sembler plus riche que la nôtre. Qu’est-ce qui justifie cette disparité ?
Les littératures marocaine et algérienne se sont développées de manière très différente. En Algérie, le poids colonial, la lutte pour l’indépendance et le contexte politique n’étaient pas les mêmes qu’au Maroc, et ont eu une influence importante sur la production littéraire. Cela a joué un rôle dans l’émergence et la convergence de certaines pratiques d’écriture en Algérie.
Au Maroc, cette effervescence s’est plutôt faite autour de revues, telles que Souffles, qui a permis de rassembler énormément de voix, avant que ne naissent des trajectoires individuelles avec des directions très différentes. Ce qui est sûr, c’est qu’il faudrait plus de dialogue entre les littératures maghrébines.
Aujourd’hui, on parle beaucoup d’une littérature “décolonisée”. Dans le contexte maghrébin, cela doit-il nécessairement passer par un détachement de la langue française ?
La décolonisation ne se fait pas au seul niveau de la langue, mais aussi du contenu, des méthodes et de la manière avec laquelle nous développons et articulons nos pensées. En relisant Souffles, on comprend très bien que la démarche de cette génération d’écrivains était de s’approprier la langue française et de la réinventer.
Ils ne voulaient plus du français tel qu’il leur a été inculqué. Mohamed Khaïr-Eddine est un écrivain qui a mobilisé la langue française de manière extrêmement originale, parfois violente et déroutante, à des fins littéraires et politiques.
Selon moi, cet effort de décolonisation doit passer d’abord par la relecture critique du travail produit sur notre société par le colonisateur, et la réinvention de concepts adaptés à notre propre réalité.
Notre rôle aujourd’hui est de réconcilier les composantes de la situation linguistique dont nous avons hérité, de sorte à faire circuler la production culturelle au-delà des champs où elle est habituellement confinée.
En tant que chercheur basé à l’étranger, quelle évaluation faites-vous de l’exportation de notre littérature par-delà les frontières marocaines ?
Il est très intéressant de noter que durant les dix dernières années, il y a eu un intérêt croissant pour les littératures maghrébines, dont la marocaine, que ce soit en français ou en arabe.
On le voit à travers l’accélération du nombre de traductions de certaines œuvres vers l’anglais. Selon moi, cet engouement est lié notamment aux révoltes arabes de 2011. A l’étranger, il y a eu ce besoin de réévaluer notre histoire pour comprendre pourquoi 2011 a eu lieu. Et cela passe par notre littérature.
Par exemple, Nous avons enterré le passé de Abdelkrim Ghellab est paru en anglais en 2018. Nous en sommes à deux traductions anglaises de Mohamed Khaïr-Eddine, avec deux autres actuellement en cours.
Abdellatif Laâbi a eu droit à une énorme anthologie de 800 pages en anglais. En 2016, une anthologie de la revue Souffles a vu le jour. En 2020, Le passé simple de Driss Chraïbi a été réédité dans une prestigieuse collection new-yorkaise spécialisée dans les classiques de la littérature mondiale.



