C’est l’histoire d’un manuscrit, ou plutôt de feuillets dispersés et jaunis par le temps, perdus pendant des décennies au fond d’une malle dans un vieux château situé dans les alentours de Bruxelles. Ces écrits datent de 1937, du temps où leur auteur, le peintre Nicolas de Staël, effectuait un long séjour au Maroc.
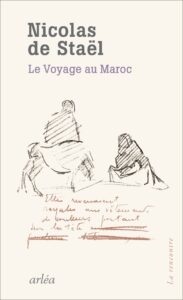
De Rabat à Marrakech, en passant par Fès et Agadir, le jeune artiste, âgé de tout juste 21 ans, traverse le pays pendant quinze mois et s’attache tout particulièrement aux villages amazighs du Sud. De ce voyage qu’il aurait souhaité prolonger de deux ou trois ans, Nicolas de Staël dit tirer l’apprentissage d’une vie.
A cette époque, il n’est pas encore devenu le peintre difficilement classable dont le nom résonne à travers l’Europe. En octobre 2023, quelques semaines après le début de la rétrospective qui lui est actuellement consacrée au Musée d’art moderne de Paris, sa petite-fille Marie du Bouchet a publié, aux éditions Arléa, Le voyage au Maroc, qui regroupe des textes inédits rédigés lors de ce voyage, suivis d’une correspondance du peintre avec ses parents.
Loin de la carte postale, on retrouve dans ces écrits un regard profondément poétique, la fraîcheur et la naïveté d’un artiste qui se cherche, et un amour sincère pour un pays rencontré par hasard.
Un artiste de passage
Lorsque Nicolas de Staël embarque pour le Maroc en 1936 depuis Bruxelles, il a deux engagements. Le premier, faire parvenir les toiles qu’il devra peindre pendant son séjour au collectionneur belge Jean de Brouwer, qui finance son séjour. Le deuxième, écrire un reportage que la revue catholique progressiste Bloc va publier. Le texte s’intitule alors Les gueux de l’Atlas : un titre qui fait grincer des dents en 2024. Néanmoins, “les gueux ne sont pas ceux que l’on croit”, signale d’emblée Marie du Bouchet dans son introduction de l’ouvrage.
Une observation qui se confirme à la lecture du reportage et des correspondances qui composent le livre. Subtilement, Nicolas de Staël ne fait pas référence au petit peuple qu’il a rencontré dans les régions rurales, mais aux complices de la colonisation, qui voient dans l’exploitation une aubaine commerciale. “Le peuple des rêveurs a été remplacé par le peuple des centimistes”, écrit-il dans une lettre datée de 1937.
Et d’émettre une critique acerbe, dès 1937, du protectorat et de ses méthodes : “Les Français font tous leurs efforts pour enlever aux musulmans leur religion, et cela sans se douter, peut-être, qu’ils n’ont rien à leur donner à la place”. Tout au long du reportage, le ton et les observations du jeune Nicolas de Staël tranchent avec le regard du touriste visitant le Maroc dans les années 1930.
Plutôt que de s’intégrer à la communauté étrangère, il dénonce la manière dont la misère des Marocains est vue comme un spectacle par les colons : “Souvent, le monde paraît un théâtre odieux où quelques gens confortablement assis regardent en souriant souffrir les autres (…) Un public disparate et barbare de Français, d’Anglais, d’Américains échappés du scénario de La Ruée vers l’or, des militaires gras aux filles de bordel, des milords aux Judas offensent le soleil, chôment et regardent”, écrit Nicolas de Staël dans les premières pages de la version originale de son reportage.
De ses quarante pages de récit, dont le ton et le positionnement tranchent avec la bien-pensance coloniale européenne, la revue publiera moins de la moitié, sous le pseudo Michel Servet. Et le “reportage” sera largement réécrit et édité. Un polissage qui ne plaît pas à l’auteur : “Quatre pages seulement ont paru et bien changé, je ne reconnaissais plus ce que j’avais écrit moi-même. Si un jour à Bruxelles on me demande ce que je pense des colonies, j’espère ne pas avoir peur de dire que le travail ici fut négatif et devient de plus en plus mauvais”, confie-t-il à sa mère. “On n’a rien fait (dans les colonies, ndlr). Ou plutôt beaucoup de mal, un peu de bien”, affirme-t-il dans la même lettre, s’adressant cette fois-ci à son père.
Tout en couleurs
“Le travail avance lentement mais avance. J’ai fait dans la cour un atelier de sculpture, des caisses servent de selles et la terre des potiers est excellente. Ma vie ici a tout à fait changé depuis le début. Je travaille mieux, avec moins d’inquiétude, moins de désespoir”, écrit Nicolas de Staël à sa mère en février 1937, depuis Marrakech.
Il a déjà visité plusieurs villes et villages, et rencontré le pacha El Glaoui à plusieurs reprises : il cultive d’ailleurs une certaine aversion pour les “grands seigneurs du Sud”. Par moments, il loge chez Charles Sallefranque, professeur au collège Moulay Idriss à Fès, puis au collège musulman Sidi Mohammed à Marrakech.
Pourtant, ce sont les Amazighs qui retiennent le plus son attention : “Dans leurs moindres gestes les Berbères vibrent de vie, de vie brûlante, et si le supérieur dans l’échelle du vital est bien de vivre, il n’y a plus aucun doute : c’est nous qui sommes des sauvages”, écrit-il.
Et de saisir, déjà, l’effacement du peuple amazigh de l’histoire. Dès lors, sa palette de couleurs sera également inspirée de celles qui font la singularité de la culture amazighe : “Il y a beaucoup d’étoiles dans le ciel, et ces bleus Berbères semblent en faire partie”, peut-on lire.
Au fil des mois, le voyage initiatique prend forme : “Le Maroc est tellement beau qu’il faudrait y faire une académie de peinture, les couleurs étant d’une vivacité et d’un calme en même temps comme nulle part ailleurs”. En quinze mois, Nicolas de Staël ne vend aucune toile au Maroc, mais les offre à ses hôtes pour les gratifier de leur hospitalité.
Pendant ce temps, son mécène Jean de Brouwer s’impatiente, car les œuvres qu’on lui a promises tardent à arriver. Le jeune artiste entreprend de renouveler son visa, souhaitant à tout prix prolonger son séjour : “Je voudrais absolument rester ici plus longtemps pour avoir de sérieux résultats. Je n’ai jamais eu à ma disposition autant de livres, autant de modèles, autant de joie (…) Quel rêve de pouvoir rester trois ans ou deux ans seulement en Afrique du Nord”, songe-t-il.
Mais son visa ne sera pas renouvelé. Après avoir envoyé six toiles à Brouwer, il finit par quitter Marrakech. à quelques semaines de son départ, il écrit : “On apprend à voir les couleurs ici. Je travaille sans cesse et je crois plutôt que la flamme augmente chaque jour et j’espère mourir avant qu’elle ne baisse (…) Tout ce que je pourrais vous dire sur le Maroc je ne parviendrai pas à le mettre en quelques volumes mais une seule chose importe – je peins”.




