Dans Petites mythologies marocaines (éditions La Croisée des Chemins), l’ancien journaliste et chroniqueur Najib Refaif s’amuse des transformations sociales d’un Maroc moderne, où tradition et modernité se confondent constamment.

Il en ressort ce que le chroniqueur qualifie de nouveaux “mythes urbains”, qui caractérisent la société dans laquelle nous évoluons.
D’un œil tendre et amusé, il les restitue dans une série de micro-récits, s’apparentant à l’exercice maîtrisé de la chronique.
Sous un nouveau jour, l’auteur revisite les rites qui encadrent nos traditions sociales, tels que le Ramadan, la circoncision ou encore l’Aïd El Adha, et s’interroge sur les couches de modernité qui y ont été ajoutées.
Lorsqu’on évoque des mythes, on imagine plutôt des légendes ancestrales. Pourtant, dans votre récit, ce mot s’applique à des choses presque invisibles de notre quotidien, telles que les selfies ou encore la darija. Quel est le sens de ces “mythes” que vous proposez d’explorer ?
Effectivement, la définition classique du mythe évoque des récits légendaires, qui ont plus ou moins été répertoriés, et qui se sont transmis au fil des générations. Dans ce livre, il faut comprendre le mythe dans le sens du récit et de la croyance.
Le mythe urbain serait une manifestation sociale pas tout à fait spontanée, résultant plutôt d’une construction, qu’elle soit commerciale ou publicitaire, par exemple. En écrivant ce livre, j’ai donc voulu observer ces petites choses quotidiennes, ces petits “riens” qui sont arrivés sans que l’on s’en rende vraiment compte, et décrire la place qu’ils avaient progressivement pris dans notre société, en raison de l’importance sociale qui leur a été octroyée.
Le plus intéressant, c’est que ces petits “riens”, particulièrement modernes, sont eux-mêmes issus de traditions très anciennes, provenant même de la religion. Le mythe moderne du “halal”, par exemple : il s’agit d’observer comment nous en sommes venus aujourd’hui à l’invention et la commercialisation du “saucisson halal”. C’est voir comment le mythe moderne se télescope avec la tradition, donnant lieu aux petites choses qui font la société d’aujourd’hui.
N’est-ce pas le travail d’un sociologue d’observer de telles évolutions ?
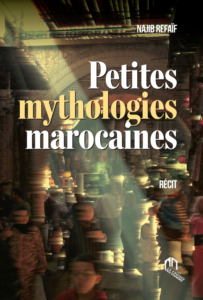
Le rôle du sociologue, que je ne suis pas, serait d’analyser. En tant que chroniqueur, j’ai la liberté d’observer et de m’amuser du temps qui passe, en le décrivant dans ces récits, qui se retrouvent finalement à l’intersection de la chronique et du journal.
Je pars du principe que ces petits riens en disent parfois plus sur nous que les grands événements qui font les gros titres de la presse.
Là où le journaliste se doit de relater et d’expliquer des faits saillants, le chroniqueur peut se permettre de tout simplement raconter, d’après son propre point de vue. Et c’est aussi avec cette subjectivité assumée que j’ai voulu raconter ces Petites mythologies marocaines.
Dans ce livre, vous interrogez notamment la relation entre mythe et tradition. Lequel a donné naissance à l’autre ?
Il y a, dans un premier temps, les mythes fondateurs, comme celui d’Abraham, qui va donner naissance à la tradition de l’égorgement du mouton. Mais cette même tradition va être réinventée, transformée en mythe urbain, lorsque le rituel se modernise à travers un ensemble de facteurs, comme les pratiques marketing.
La boucle est alors infinie : le mythe raconte une histoire, l’historien la recueille, le mythomane la déforme, le romancier l’écrit… à la différence du mythe ancien, dont il n’est pas tellement question dans ce livre, la légende urbaine est située dans le temps et l’espace : elle peut aussi bien se dérouler dans un hammam qu’en plein centre-ville.
Par ailleurs, les mythes qui nous entourent ne viennent pas seulement de chez nous. Le cinéma, par exemple, a introduit un ensemble de mythes urbains qui encadrent notre imaginaire collectif.
Lorsque dans les salles obscures, on regardait les travaux d’Hercule ou les pérégrinations d’Ulysse, ce n’était pas Homère que nous avions en tête, mais simplement des récits d’aventures épiques modernes, calquées sur des mythes anciens.
Je me souviens de la série américaine Dallas, qui était diffusée sur l’unique chaîne de télévision qu’on avait à l’époque. Elle était doublée en français, et racontait la vie de riches pétroliers américains, qui enchaînaient beuveries et adultères.
Rien à voir avec le milieu populaire et conservateur des centaines de milliers de Marocains qui la regardaient, scotchés devant leur poste de télévision. Et pourtant, ils s’y sont identifiés, et l’imaginaire collectif s’est nourri de cette représentation des ètats-Unis.
«Petites mythologies marocaines»
85 DH
Ou
En tant qu’ancien directeur de la fiction à 2M, vous savez quelque chose de la manière dont la télévision est, elle aussi, à l’origine d’un certain nombre de mythes sociaux…

C’est le propre même de la fiction que de créer des mythes. La programmation ramadanesque télévisée en est l’exemple parfait : pendant un mois, les foyers regardent la même chose, à la même heure, en mangeant la même chose.
La télévision fait pour ainsi dire partie du rituel du ftour marocain. C’est le rêve de tout producteur de télévision ! (rires)
Plus qu’un vecteur des mythes marocains, la télévision produit les mythes et les renforce par le biais de la fiction.
Diriez-vous que ces petites mythologies marocaines, présentes dans notre quotidien, participent à la construction de l’image que nous avons de nous même en tant que société ?
Je dirais qu’elles étayent cette image, plus qu’elles ne la construisent, dans la mesure où le discours dominant à l’heure actuelle est celui d’une société qui s’attache à préserver la tradition, tout en la conciliant avec la modernité.
Et c’est précisément ce qu’illustrent ces mythes modernes, lorsque des hôtels cinq étoiles proposent des formules spéciales “Aïd El Adha”, ou que les supermarchés vendent des bières sans alcool. Nous ne nous définissons pas forcément par ces éléments, mais nous les observons au quotidien, et savons qu’ils font partie de notre société.
D’ailleurs, cette tension entre tradition et modernité revient à chaque grand débat social. En ce qui me concerne, je pense qu’une rupture épistémologique est nécessaire pour passer de l’une à l’autre. Comme disait un célèbre prix Nobel, ce n’est pas en améliorant la bougie que l’on a inventé l’électricité (un proverbe attribué à Niels Bohr, physicien danois lauréat du prix Nobel en 1922, ndlr).
Parce qu’il trie l’actualité et sélectionne les faits qui méritent d’être racontés, le journaliste participe-t-il lui aussi à la création des mythes ?
Bien sûr, parce qu’à son échelle, le journaliste crée et produit des récits, qui seront à leur tour repris et relatés. L’histoire de cet arbre l’illustre bien. Dans le Rabat des années 80, il était question d’un arbre situé près de la place Piétri qui se serait soudainement mis à saigner.
Des journalistes ont rapporté que ce “saignement” était lié à la décision des responsables d’un chantier de le couper. Or, il s’agissait non pas de sang humain ou animal, comme pouvait le laisser supposer les titres de journaux, mais de sève rouge.
Un débat écologique a alors été engagé, et plusieurs habitants ont protesté contre l’abattement de l’arbre, qui trône encore à ce jour dans le centre-ville de Rabat. Ceux qui se souviennent encore de cet épisode conservent l’image de cet arbre qui “pleure du sang”, désormais propulsé au rang de mythe urbain.
Dans “Carte de presse”, qui est également un recueil de chroniques, vous revenez sur votre carrière de journaliste culturel, et sur les transformations de la presse marocaine. A-t-elle beaucoup changé, depuis les années 80 ?
Je pense que l’une des différences majeures, au-delà du fait que la presse était beaucoup plus lue à l’époque, est que j’ai commencé le journalisme à l’époque où celui-ci était surtout partisan. à l’époque, “journal indépendant” signifiait “qui n’appartient pas au gouvernement, ni à un parti politique”, car ceux-là disposaient tous d’un pendant arabophone et d’un francophone.
Même les nationalistes, qui luttaient pour l’arabisation, avaient un organe médiatique francophone. Autrement dit, on était soit journaliste d’agence, soit journaliste militant, affilié à un parti politique. Et puis il y avait des journalistes qui n’appartenaient pas vraiment à l’une de ces catégories, et qui, comme moi, ont trouvé refuge dans la presse culturelle.
Ça nous octroyait une certaine liberté par rapport à la censure, ou du moins, aux contraintes éditoriales classiques d’un journal partisan. Abdellatif Laâbi était en prison, mais parce que j’écrivais sur la culture, rien ne m’empêchait de parler de ses livres.
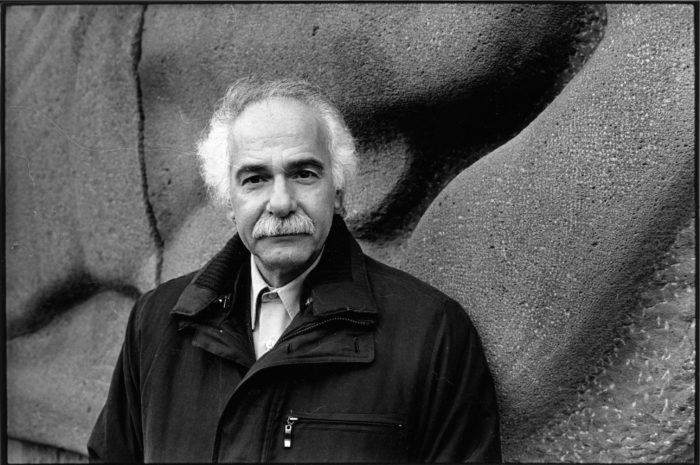
Pensez-vous que dans le paysage médiatique actuel, il est impossible pour un journal culturel spécialisé de se pérenniser ?
Il est vrai que l’absence de médias culturels est souvent déplorée, à juste titre d’ailleurs. Le grand paradoxe de notre époque, c’est qu’il est plus facile d’être journaliste aujourd’hui que ça ne l’était il y a quarante ans.
“Dans les années 1980, un journaliste culturel n’avait pas beaucoup de matière à traiter”
Pour trouver la référence d’un livre, nous n’avions pas de moteur de recherche à disposition : il fallait se rendre à la bibliothèque générale. Dans les années 80, un journaliste culturel n’avait pas beaucoup de matière à traiter : il y avait certes une “floraison” de peintres, mais l’activité culturelle du pays était très faible. Un ou deux films marocains sortaient par an, et en littérature, on avait à peine les parutions de Abdellah Laroui, Driss Chraïbi, et Tahar Ben Jelloun…
Malgré ça, les suppléments culturels existaient, et même les revues spécialisées telles que Al Takkafa Al Jadida de Mohammed Bennis, ou encore le journal Mawakif. Aujourd’hui, tout cela a disparu, alors que la matière culturelle est beaucoup plus importante.
A l’époque, nous, journalistes culturels, rêvions de créer des magazines spécialisés. J’ai au moins cinq ou six maquettes qui n’ont jamais vu le jour ! Mais nous n’avions pas un rond pour le faire, et les grands patrons de presse n’ont jamais été particulièrement enthousiasmés par l’idée de mettre de l’argent dans la culture. Alors, beaucoup ont fini par se convaincre que la culture, ça n’intéresse personne.
Pensez-vous qu’il est aujourd’hui nécessaire de faire connaître l’histoire de la presse marocaine ?
On en revient à l’importance du récit. Car comme diraient certains, tout ce qui n’a pas été écrit n’existe pas.
Je pense que si l’histoire de la presse marocaine est méconnue, et par conséquent, l’état actuel de la presse marocaine l’est aussi, c’est surtout parce qu’un journaliste, par définition, parle de tout sauf de lui-même. Son travail est d’écrire sur les autres.
C’est pour ça aussi que j’ai voulu écrire Carte de presse, un petit témoignage modeste sur la presse marocaine telle que je l’ai vécue.
Le père de la presse francophone Abdellah Stouky, disparu en juillet dernier, a beaucoup compté dans votre parcours. Quel souvenir conservez-vous de lui ?
C’est grâce à lui que j’ai pu me réfugier dans la culture. J’ai travaillé avec lui, dans la rédaction d’Al Maghreb, mais aussi dans le défunt magazine Message de la nation, qu’il avait fondés. J’avais tenu à ce qu’il rédige la préface de mon premier recueil de chroniques, Un temps marocain.
Voilà un homme de presse, mais aussi un homme de culture, dont j’aurais aimé lire les mémoires. Il a signé ses premiers articles à 18 ans seulement, et avait collaboré avec la MAP avant même qu’elle ne devienne une agence publique !
Il a tellement apporté au paysage médiatique marocain, qui ne retiendra pas grand-chose de lui finalement. S’il y avait quelqu’un qui aurait pu retracer avec précision l’histoire de la presse marocaine depuis l’indépendance, c’est bien lui.
«Petites mythologies marocaines»
85 DH
Ou

 Achetez par whatsapp
Achetez par whatsapp

