Dans un essai d’une centaine de pages, l’ancien directeur de l’Institut d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC), Ahmed Massaia, également écrivain, a tenu à s’adresser à son éditeur.
Dans Lettre à mon éditeur, Réflexions sur l’édition francophone au Maroc, il interpelle explicitement Abdelkader Retnani, fondateur de la maison d’édition La Croisée des chemins, nommé à plusieurs reprises dans le texte, et pointe les responsabilités des éditeurs marocains dans la dégradation de la chaîne du livre.
Loin du règlement de compte personnel, Ahmed Massaia livre plutôt une réflexion critique sur la dégradation du secteur du livre, qu’il impute à plusieurs acteurs de ce même secteur.
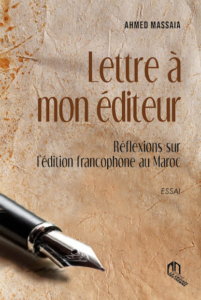
Car si l’éditeur est le premier destinataire de cette longue lettre ouverte, il n’en demeure pas moins que l’essayiste, qui a par ailleurs codirigé la collection “Le royaume des idées” dans cette même maison d’édition, s’en prend aussi aux libraires ainsi qu’aux diffuseurs, aux auteurs et au ministère de tutelle.
Sévère mais bienveillant, Ahmed Massaia ne tombe pas non plus dans le fatalisme : bien qu’assombri par un ensemble de failles et de pratiques non conventionnelles, le paysage littéraire n’est pas mort, et il y aura toujours des auteurs qui, malgré tout, continuent d’écrire.
En témoigne une lettre inédite, datée de mai 2020 et adressée à l’auteur, du penseur Abdallah Laroui, qui répond à la question “pourquoi j’écris” et dont l’intégralité a été retranscrite dans l’essai.
Vous avez traversé une période difficile, question santé. Vous dites que c’est précisément la peur de ne plus pouvoir lire et écrire qui vous a amené à réfléchir sur le paysage littéraire francophone…
J’ai eu très peur. Je ne voyais littéralement que du noir. Je perdais progressivement la vue, et parmi toutes les choses qui m’inquiétaient, il y avait l’angoisse de ne plus jamais pouvoir lire et écrire. C’est à partir de là que je me suis mis à longuement réfléchir sur ma situation de lecteur et d’auteur marocain.
D’une certaine manière, je me suis mis à rapprocher ce brouillard qui entravait ma vue de celui qui prédomine dans ce paysage littéraire. Et tant que le secteur ne sera pas encadré par des politiques culturelles et éditoriales structurelles, nous resterons, auteurs, éditeurs et lecteurs, dans l’expectative et le brouillard.
Parce qu’il y a du soleil chez nous, on fait l’erreur de penser que notre culture est dynamique. C’est faux ! Le véritable problème, c’est que nous avons normalisé une forme de médiocrité culturelle ambiante sur le plan qualitatif. Et lorsqu’on voit certains acteurs culturels se féliciter les uns les autres, on tombe même dans l’éloge de la médiocrité.
Pourquoi avoir fait le choix de vous adresser précisément à Abdelkader Retnani, alors que cette lettre, finalement, est une lettre ouverte ?
Parce que j’estime que Abdelkader Retnani est l’un des plus grands éditeurs du Maroc, probablement le plus célèbre et influent, omniprésent et incontournable dans la chaîne du livre marocain. C’est un fait.
C’est un professionnel du livre avec qui je discute souvent. Je ne suis pas d’accord avec lui sur beaucoup de choses, et je ne manque pas de le lui dire. Mais contrairement à beaucoup, il est disposé à écouter et à discuter. Cela ne veut pas dire qu’il obtempère systématiquement, mais il faut lui reconnaître le mérite d’être ouvert à la discussion et au débat.
D’autre part, je voulais poser des problèmes concrets, parler de la responsabilité des éditeurs dans les problèmes que rencontre le livre marocain. Par conséquent, je n’ai pas voulu recourir aux pronoms indéfinis. Il m’a semblé naturel de m’adresser à celui qui a publié trois de mes précédents essais (Un désir de culture, Une humanité à partager, Eloge de la citoyenneté, ndlr).
Abdelkader Retnani a tout de même publié cet essai. Comment a-t-il réagi à la lecture du texte, ainsi qu’aux reproches qu’il contient ?
Je lui ai remis ce texte il y a plus d’un an, et de longues discussions s’en sont suivies. Il a lu le manuscrit et avait bien entendu des remarques à me formuler. Parfois nous tombions d’accord, parfois pas du tout.
En tant que “publieur” et “publié”, il va de soi que nous portons des conceptions différentes sur un certain nombre de sujets. Ainsi, nous avons passé plus de dix jours à débattre sur un seul mot. Des concessions ont été faites dans les deux sens.
Le processus de publication de cet essai, qui est aussi un récit, a été l’occasion de mener un véritable dialogue avec mon éditeur, concernant tous les acteurs de la chaîne du livre, en passant par la maison d’édition, les diffuseurs et les libraires…
“Ce texte est aussi une autocritique. Les auteurs ont leur part de responsabilité”
Je ne voudrais pas que le titre, Lettre à mon éditeur, occulte le fait que ce texte est aussi une autocritique. Il ne serait pas raisonnable de mettre tous les maux de la littérature francophone de notre pays sur le dos des éditeurs. Les auteurs ont leur part de responsabilité, notamment dans la complaisance mutuelle que beaucoup entretiennent, mais aussi dans la marginalisation de notre littérature à l’échelle francophone.

Qu’est-ce qu’un auteur se doit d’attendre de son éditeur ?
Ce qui manque chez nous, c’est avant tout une expérience humaine. Généralement, la relation entre l’éditeur et l’auteur se réduit à un processus très mécanique : le manuscrit est accepté sans trop de difficulté, on attend de connaître la hauteur de la subvention du ministère pour décider du tirage, on reçoit les corrections, et puis on attend la sortie du livre, qui mourra rapidement en librairie.
Je trouve ça très triste. La maison d’édition se doit d’être un lieu familier pour un auteur, c’est un endroit qu’il doit connaître, un lieu où il puise à la fois des déceptions et des suggestions. Nous en sommes encore au stade où beaucoup d’éditeurs n’ont même pas de bureau à proprement parler.
La complaisance des éditeurs n’est-elle pas elle aussi responsable de la baisse de qualité de la production littéraire francophone ? L’éditeur ne devrait-il pas être, avant tout, le critique le plus sévère du texte qu’il reçoit ?
Je vous l’accorde complètement. Certains ne lisent même pas les manuscrits qu’ils reçoivent, d’autres sont incapables de critiquer un texte d’un point de vue littéraire. Ce côté technique de la littérature est absent.
Quant à ces manuscrits trop facilement acceptés, ils le sont surtout parce qu’il n’existe pas de comité de lecture professionnel. On oublie qu’un écrivain n’a pas la science infuse : il peut écrire un mauvais roman, quelque chose d’impubliable, et quelquefois, le rôle d’un éditeur est de refuser de publier.
Et même quand le manuscrit achève son parcours, et que le livre est en librairie, on y trouve de graves anomalies typographiques, allant du mot coupé à la faute d’orthographe. Nous en sommes encore au stade où certains éditeurs sacrifient même la mise en page conventionnelle pour ne pas dépasser un certain nombre de pages par exemplaire.
Vous concédez que les éditeurs ne sont pas seuls en cause, et pointez notamment, entre autres, les échecs d’un ensemble d’initiatives menées par le ministère de tutelle : Nuit de la lecture, salons littéraires régionaux, plan d’action de 2005 pour la lecture… Quel est, selon vous, le facteur commun de ces échecs ?
Aucune de ces initiatives n’a jamais été accompagnée d’une vision, ni de prise de position ferme et irrévocable. Nous avons un ministère de tutelle qui gère le quotidien des acteurs du livre, mais qui n’entreprend pas de véritables chantiers de réforme basés sur une vision de fond.
On croit que le rôle d’un ministère est de distribuer des subventions. Prenez l’exemple de Mehdi Bensaïd, le ministre actuel : quel projet en faveur du livre, ou même du théâtre, a-t-il mis en place ?
La dernière édition du Salon international de l’édition et du livre, à Rabat, a tout de même enregistré une affluence notable, avec plus de 200 000 visiteurs, et son organisation a été louée par de nombreux acteurs culturels…
Parce que c’est déjà un évènement important et visible, que les gens attendent avec impatience. Le SIEL a presque trente ans, c’est un rendez-vous établi et pérenne. Effectivement, en termes d’organisation, la dernière édition était remarquable.
Mais encore une fois, c’est sur le fond, et plus précisément sur la programmation, qu’il y a à redire. Comment expliquez-vous des tables rondes face à des chaises vides, avec une ou deux personnes dans la salle ? Avoir un seul évènement littéraire d’envergure nationale et issu d’une initiative publique ne suffit pas.
Il y a un nombre considérable de fonctionnaires au sein du département du livre, et il semblerait que leur seule mission, sur les 12 mois de l’année, est de préparer le SIEL et de gérer des dossiers de subventions. Mais on ne peut se cantonner à cela ! Leur mission devrait être d’imaginer des projets qui ne restent pas au stade d’idées sur papier, ainsi que d’insuffler une dynamique auprès des libraires, éditeurs, diffuseurs…
Votre essai témoigne d’une grande admiration pour l’ancien ministre de la Culture Mohamed Achâari. Vous semblez dire que depuis son mandat, nous manquons d’une véritable politique culturelle, issue d’une sensibilité à la chose culturelle, mais aussi, d’une vision…
Mohamed Achâari était, contrairement à la plupart de ses successeurs, un homme issu du milieu de la culture : c’est un poète, un écrivain, qui a notamment présidé l’Union des écrivains marocains.
On pouvait ne pas être d’accord avec lui, mais il avait le mérite d’être un homme qui a longuement réfléchi à la complexité de la chose culturelle avant de devenir ministre de la Culture. Par conséquent, il est arrivé avec une vision et un projet politiques concernant la culture.
A ce jour, c’est l’un des seuls ministres qui, dès sa nomination et l’ouverture du parlement, a présenté un plan d’action culturel en neuf points, qu’il a commencé à exécuter.
Je pense que lorsque les politiques culturelles rencontrent des dysfonctionnements aussi complexes que ceux que nous traversons actuellement, il est nécessaire que la question soit reprise par un visage qui incarne une idée et une vision de la culture, et pas seulement par une succession d’hommes politiques nommés à ce poste…
Les éditeurs continuent de dépendre des aides et subventions du ministère de la Culture. Pensez-vous que ces dernières contribuent à renforcer le manque d’autonomie des maisons d’édition qui en bénéficient systématiquement ?
On ne peut pas vivre dans un pays où la culture est exclusivement un service public. En janvier dernier, le ministre de la Culture a signé une convention de coopération pour le développement des industries culturelles et créatives, une initiative très louable. Sauf qu’entre la mise en place d’une industrie et l’état actuel du secteur, il y a un grand pas.
Lorsque dans le meilleur des cas, un livre se vend à 1000 exemplaires, il faut comprendre concrètement ce que ça implique : ni l’auteur, ni l’éditeur, ne peut vivre des recettes engendrées. Dans l’état actuel des choses, on ne peut pas nier que les subventions sont nécessaires, et que de nombreuses maisons d’édition en dépendent afin d’assurer leurs parutions.
Le problème est que beaucoup s’en contentent, et ne tentent pas de transformer ces subventions et aides en appui afin de devenir des entreprises pérennes et viables, capables de s’entretenir.




