Sous ses faux aspects académiques, Les maladies de la littérature est avant tout un texte ancré dans le quotidien, composé d’une quinzaine de courts textes presque indépendants les uns des autres.
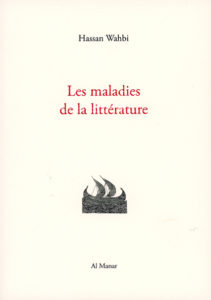
Tour à tour, le poète Hassan Wahbi se lance dans un enchaînement de réflexions sur son métier de professeur de lettres, ses pratiques de lecture et d’écriture.
L’auteur ironise élégamment sur les “bibliophobes”, se glisse dans la peau d’un homme dont la bibliothèque vient de disparaître, met en garde contre ceux qui disent la littérature plus qu’ils ne la vivent…
Les maladies de la littérature serait-il finalement un éloge ? “C’est en tout cas la vision d’une littérature comme second souffle, une réflexion sur la littérature avec la littérature”, tente de résumer l’auteur. Une réflexion, car c’est avant tout un texte qui pose plus de questions qu’il n’apporte de réponses sur cette chose vaste, complexe, parfois intimidante et effrayante qu’est la littérature.
Et c’est tant mieux, car un véritable poète ne peut que se méfier des réponses tranchées et des affirmations trop hâtives. Après le recueil de poèmes La nuit humaine (aux éditions Le Fennec) paru en janvier 2022, qui interroge le rapport du poète au deuil, Hassan Wahbi aborde Les maladies de la littérature avec un ton plus léger, mais non moins empreint d’une profondeur et d’une humilité qui font la justesse de son regard.
Aimer la littérature, nous dit-il, n’empêche pas de se demander si celle-ci est véritablement utile, ou encore, sur un ton plus dérisoire, s’il ne faudrait pas mettre en place une police littéraire pour interdire les mauvais romans. Et c’est d’ailleurs avec cette même pointe d’humour que Hassan Wahbi se livre.
Contrairement à vos précédents recueils de poésie, ‘Les maladies de la littérature’ est un ouvrage difficilement classable. Hybride, certains le qualifieraient d’essai, d’autres de recueil de courtes nouvelles… Où le situeriez-vous dans votre bibliothèque ?
On a souvent tendance à vouloir classer les livres selon les frontières du genre, sauf que celles-ci sont rarement rigides. Il y a un jeu qui s’opère au sein d’une bibliothèque, et Les maladies de la littérature est né de ce jeu.
J’ai commencé ce livre il y a une douzaine d’années. Lorsque l’occasion se présentait, je revenais à ce texte à partir de divers moments vécus qui me permettaient de réfléchir à la vérité de la littérature.
Il s’agissait souvent de me poser une question qui me travaille beaucoup : la littérature est-elle réjouissance ou malédiction ? Après tout, que de livres a-t-on adorés, que de livres ont été brûlés…
C’est principalement de cette question qu’ont découlé les textes qui composent cet ouvrage. On y retrouve des réflexions sur la lecture, l’écriture, la relation entre la littérature et le monde, quelques notes assassines par moments…
Je ne pense pas que cette indétermination du genre littéraire soit un défaut, ni qu’il faille nécessairement adopter un esprit scolaire pour pouvoir réfléchir à la vérité de la littérature. C’est, au contraire, lorsqu’on oublie tout ce qu’on a appris que l’on peut se construire une identité littéraire, et aborder les questions qui nous habitent.

Justement, quelles sont les questions qui vous habitent lorsque vous écrivez ?
“Celui qui écrit est souvent plongé dans l’opacité de lui-même”
J’écris pour découvrir. Je pense souvent à cette phrase de Marguerite Duras : “Écrire pour savoir ce qu’on est capable d’écrire.” Celui qui écrit est souvent plongé dans l’opacité de lui-même, c’est celui qui le lit qui a une vision plus claire du texte.
Paradoxalement, c’est aussi dans cette opacité que l’on peut trouver des choses qui nous guident, mais ce n’est possible qu’en cheminant petit à petit. Lorsque j’écrivais La nuit humaine, ce qui m’habitait était de savoir comment survivre après un deuil.
Aujourd’hui, il m’est impossible d’écrire sur quelque chose qui ne me déchire pas. Je pense qu’il y a une part d’ombre et de lumière dans chaque processus d’écriture, et que celles-ci ne sont intéressantes que dans leur conjonction, dans leur manière de correspondre.
Prenons au mot la métaphore qui fait le titre de votre ouvrage, ‘Les maladies de la littérature’. Qu’y a-t-il d’ordre pathologique dans la littérature ?
Il s’agit de penser la littérature dans ses difficultés. Écrire ne va pas de soi, et c’est un processus qui s’accompagne souvent d’un désir de renoncement. L’écriture n’est pas souffrance, mais elle est une double source de difficulté.
Il y a quelque chose que la littérature ne règle pas, tout en donnant l’impression de le faire. Un faux remède en quelque sorte, de la même manière que l’amour ne règle pas les choses, mais donne l’impression de le faire.
Cette idée de pathologie est aussi à mettre en lien avec une forme d’obsession : il y a des auteurs qui ont rêvé de renoncer à la littérature, mais qui n’y sont jamais parvenus. Ils instaurent des rituels d’écriture : certains écrivent dans des cafés, d’autres dans leur salle de bain, il y a ceux qui, comme Michel Leiris, se réveillent en pleine nuit pour transcrire leur rêve de sorte à trouver matière pour écrire…
Vos réflexions partent du constat que la littérature a une présence palpable. Cette présence importe-t-elle même si, sous nos cieux, force est de constater qu’elle peut en effet occuper quelques individualités, mais pas l’espace public ?
“Nous sommes passés d’une culture orale à une culture digitale orale”
C’est tout le paradoxe des sociétés comme la nôtre, où “l’inutile utile” devient seulement “inutile”. Nous sommes passés d’une culture orale à une culture digitale orale, sans réel moment de transition par la culture écrite. C’est ce qui, à mon sens, justifie le faible ancrage de la littérature dans l’imaginaire collectif. L’acte de lire et d’écrire ne fait pas partie du quotidien.
Toujours est-il que je ne pense pas que le livre disparaît à cause de ceux qui sont illettrés, mais plutôt à cause de ceux qui sont lettrés, qui ont le moyen de lire et qui ne le font pas. Il suffit de voir combien de foyers de classe moyenne disposent d’une bibliothèque dans leur salon. Aujourd’hui, la parution d’un livre ne fait vibrer personne.
Dès lors que le livre n’est pas considéré comme un objet nécessaire au quotidien, son rôle symbolique disparaît. Quand la culture devient inutile, cela engendre un autre type d’individus dans la société : des gens qui se limitent à des contraintes économiques et matérielles…
C’est un désert social, qui fabrique des automatismes sociologiques dangereux à mon sens, où il s’agit de se contenter seulement de l’essentiel, sans jamais chercher à accéder à ce qui nous élève.
Plusieurs textes qui composent cet ouvrage se rejoignent dans une volonté de démystifier la chose littéraire… Est-ce ainsi qu’on peut la rendre plus accessible ?
Tout à fait. C’est un propos qui relève d’abord d’une démarche de sincérité intellectuelle. Malgré toute la passion que je voue à la littérature, je n’ai aucune gêne à dire que j’ai toujours détesté les préfaces, que je n’ai pas encore lu Marcel Proust, que je ne pense pas qu’un livre puisse changer une vie, qu’on peut s’ennuyer en lisant certains livres…
Cette démystification est propre à mon expérience de lecteur. Il s’agit finalement de démystifier la parole académique autour de la littérature qui, souvent, s’accompagne d’un certain nombre d’injonctions et enterre la littérature pour prôner d’abord sa théorisation.

À quoi correspond ce statut de “non-écrivain” que vous évoquez, pour un auteur qui a tout de même plusieurs ouvrages à son actif ?
C’est une façon de faire de l’échec une réussite. Le “non-écrivain” est celui qui renonce à l’écriture en attendant qu’elle vienne à lui, car il rêve à un texte idéal, sans parvenir à l’écrire. C’est une forme d’humilité, mais aussi une manière d’être.
Le “non-écrivain” est aussi une critique de ce que j’appelle “les littérateurs” : ceux qui écrivent beaucoup de petites choses, sans hésiter une seconde, et qui les qualifient de grandes choses. Un peu à la manière de ceux qui se prennent pour des poètes, alors que même les grands poètes ne se qualifient pas de la sorte.
“Rares sont les écrivains qui ont le goût de la modestie de la réception anonyme, du plaisir de l’ombre”, peut-on lire dans ‘Les maladies de la littérature’. Diriez-vous que vous faites partie de cette catégorie d’écrivains, vous qui êtes peu connu du grand public ?
Cela ne peut être qu’un projet moral de ma part. J’en reviens à cette part d’ombre que j’évoquais tout à l’heure : elle me plaît, car c’est un lieu à partir duquel j’arrive à voir le réel. Lorsque je me trouve dans un événement littéraire qui ne me plaît pas, je n’hésite pas à m’en aller. Je regrette que dans ce milieu, il arrive souvent que la comédie de la culture soit plus importante que la culture en elle-même.
Tout le monde a des choses à dire sur tout, et la démonstration prend le dessus sur la réflexion : les propos ne sont pas mesurés, peu nuancés… C’est une sorte de tyrannie du commun, où l’on a tendance à oublier la complexité de la littérature, supposée être la raison même de ce regroupement.
Par moments, j’ai aussi l’impression que certains s’intéressent moins à la littérature qu’à l’idée d’écrire un livre à tout prix, en un temps record, alors qu’aujourd’hui, même pour faire un enfant, il faudrait hésiter… (rires) Dire la littérature est une chose, l’écrire en est une autre.
Certes, de très belles choses sont publiées sous nos cieux, mais, généralement, on met sur un piédestal de la mauvaise littérature. Or, c’est à nous, lecteurs, d’être exigeants, de demander à aller vers de la bonne littérature.
Dans ce livre, la poésie fait également l’objet d’une réflexion. Vous semblez lui accorder une autonomie totale, et ne la concevez pas comme une activité qui découlerait d’autres genres littéraires. C’est rare, à l’heure de l’hégémonie du roman sur la littérature…
Cela découle d’une nécessité particulière. Il m’est impossible de concevoir la poésie simplement comme un jeu verbal, une prouesse technique de la langue… C’est pour cela, par exemple, que je n’ai jamais été adepte du surréalisme.
Je conçois la poésie comme une ultime possibilité de se traduire soi-même, et non pas comme une forme d’écriture qui permet d’aboutir à un langage poétique. C’est une quête à part entière. D’ailleurs, mes recueils de poésie s’écrivent très lentement. Certains traînent dans mes tiroirs depuis plusieurs années…




