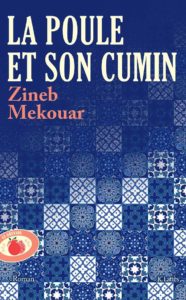
Elles s’appellent Kenza et Fatiha. La première est une “chrifa” qui grandit au sein de la jeunesse dorée casablancaise. La seconde est la fille de Milouda, la femme de ménage employée chez les Chérif Falani. Les deux filles grandissent ensemble, habitent la même maison, mais pas les mêmes pièces. L’une occupe une chambre spacieuse, l’autre, la dépendance mal chauffée des domestiques.
Pourtant, durant les premières années de leur enfance, Kenza et Fatiha ont partagé le même lit et s’endormaient main dans la main. Adultes, elles évoluent dans deux Maroc différents où leurs histoires s’entremêlent, une fois de plus. Derrière cette binarité assumée, dans un style neutre et concis, se trouve la plume de Zineb Mekouar, qui signe son premier roman aux éditions JC Lattès.
Née à Casablanca, scolarisée au lycée Lyautey, diplômée de Sciences Po Paris… la primo-romancière semble avoir mis beaucoup d’elle-même dans Kenza, l’une des protagonistes de La poule et son cumin. “Ça reste une fiction, bien entendu”, précise Zineb Mekouar. Lycéenne, elle lit et relit Albert Camus, Romain Gary ou encore Marguerite Duras, et prend goût à l’écriture. “J’ai beau faire d’autres choses à côté, il m’est vital d’écrire”, sourit-elle.
Deux mères, une vie
“Ce roman est ce qu’on peut lire de mieux sur la lutte des classes au Maroc d’aujourd’hui”, écrivait Tahar Ben Jelloun il y a quelques semaines sur La poule et son cumin. “Des récits entrecroisés (…) qui nous transportent dans des histoires intimes et douloureuses qui nous concernent toutes et tous”, relève à son tour Valérie Trierweiler, journaliste, autrice et ancienne première dame de France.
Malgré l’accueil chaleureux fait à son roman, Zineb Mekouar, 31 ans, demeure modeste. Depuis Paris, elle nous livre timidement, de l’autre bout du fil, ses premières impressions, trois semaines après la parution de La poule et son cumin. De fil en aiguille, on en arrive au cœur du sujet, en commençant par la sororité, tendre et ambiguë, qui unit Fatiha et Kenza. “C’est une relation assez cyclique, qui tente de dépasser le rapport de force auquel elle pourrait être initialement assujettie, entre la fille de la domestique et la fille des maîtres de la maison”, explique la romancière.
Entre Kenza et Fatiha, il y a de la tendresse, mais aussi, par moments, de la rivalité, de l’envie et de la jalousie. Cyclique, cette relation l’est aussi parce que les rapports de force qui la régissent ne cessent de s’inverser, loin de se cantonner à l’image d’une petite Fatiha soumise aux caprices de Kenza, la petite bourgeoise. “C’est dans cette mesure que le roman dépasse par moments le fond des classes sociales. Quand on rentre dans la complexité des relations humaines, beaucoup d’émotions se mélangent. Quels que soient le contexte, nos prédispositions sociales, on reviendra toujours à des choses aussi universelles que l’amitié, la jalousie, la rivalité…”, poursuit Zineb Mekouar.
L’amitié entre les deux petites filles, qui maîtrisent toutes deux la darija et le français, est régie par une règle tacite : Fatiha met un point d’honneur à ne s’adresser à Kenza qu’en darija, et Kenza, à ne s’adresser à Fatiha qu’en français. C’est à partir de cette petite brèche aux allures de jeux d’enfants que Zineb Mekouar adresse la complexité qu’entretiennent les Marocains vis-à-vis du bilinguisme de notre société. “Dans ce roman, j’ai voulu que la langue occupe la place d’un personnage à part entière, tant le rapport à la langue française est complexe et fascinant. C’est tantôt une fierté, tantôt un complexe”, commente la romancière. Si l’illustre Kateb Yacine qualifiait la langue française de “butin de guerre”, la préoccupation d’une nouvelle génération d’écrivains est de se demander comment s’en servir.
Le butin de guerre
Au fil des pages, la romancière dresse également le portrait d’un grand-père aigri, nationaliste et fervent militant pour l’indépendance, anciennement du palais royal et wali influent du grand Casablanca, avant d’être disgracié pour des raisons obscures. Le patriarche porte en lui un rejet profond pour la “mission française”, dont il dénonce même l’appellation. “Le mot mission renvoie encore à cette idée de mission civilisatrice coloniale, à la libération des consciences des peuples colonisés”, souligne à juste titre la romancière.

Comme dans la réalité, l’école française où évolue Kenza est un facteur pesant. Plus qu’une école, une institution ou un élément de contexte, elle apparaît comme un paramètre à part entière qui distingue un personnage de l’autre. “Ce n’est pas tant la mission en tant qu’école qui pose problème, mais tout l’héritage colonial dont elle est chargée. Le grand-père porte la fierté de la lutte pour l’indépendance. En refusant cette institution, il rejette catégoriquement l’idée que le Maroc puisse encore être sous le joug d’un autre pays. C’est un bagage historique et émotionnel, à la fois lourd et légitime”, décrit Zineb Mekouar.
À cela s’ajoute un mépris de classe comme on le connaît, que l’œil perspicace de Zineb Mekouar a su capturer. Étant elle-même lauréate des bancs du lycée Lyautey, elle parvient à décrire avec minutie les rouages de cette jeunesse dorée, ainsi que tous les processus subtils qui participent à la création de la bulle au sein de laquelle les enfants bourgeois évoluent, les détachant de la réalité de leur pays.
Une fois son bac en poche, Kenza s’envole pour Paris. Là-bas, elle est renvoyée à des stéréotypes sur les femmes maghrébines dans lesquelles la jeune étudiante ne se reconnaît pas. “À la fois en France et au Maroc, la jeunesse peut se sentir prisonnière d’une identité à laquelle elle n’appartient pas forcément. Je crois qu’il ne faut pas seulement parler des carcans marocains, mais aussi des carcans français auxquels sont assujettis les Marocains”, précise Zineb Mekouar.
Génération Y
Si La poule et son cumin navigue entre le Maroc des années 1990 et celui des années 2000, le fil conducteur de la trame narrative prend place en 2011 à Casablanca. L’année du 20-Février, d’une jeunesse qui sort manifester dans la rue munie de slogans et revendications puissantes… Pourtant, ce contexte enflammé interagit peu avec le déroulement du récit. De son côté, Zineb Mekouar confirme que le choix de ce cadre temporel n’est pas anodin. “L’année 2011 est marquante pour Kenza et Fatiha, à la fois en France et au Maroc”, explique la romancière.
“Du côté marocain, la jeunesse a soif de liberté, et pour beaucoup, comme Fatiha, ils découvrent et apprennent à revendiquer certains droits. De l’autre, énormément d’étudiants marocains en France ont fait bagage du jour au lendemain, à cause de la circulaire Guéant (visant à diminuer le nombre de ressortissants étrangers souhaitant prolonger leur expérience professionnelle et scolaire en France, ndlr)”, poursuit-elle.
Et d’ajouter : “D’une certaine manière, Kenza et Fatiha sont les deux facettes d’une même réalité.” Avortement, article 490, hypocrisie sociale, entre-soi et pistonnage… tout y passe dans La poule et son cumin. Si certaines de ces thématiques peuvent sembler surexploitées dans le paysage littéraire marocain, voire redondantes et clichées, Zineb Mekouar s’en défend : “Ce sont des thèmes tellement connotés et clivants que je pense que le territoire du roman est le meilleur moyen de les aborder, parce qu’il pointe des réalités en abordant leurs complexités. Et puis, si parler de l’avortement est devenu un cliché, soit, mais il faut bien en parler pour que les choses changent.”
À l’instar d’Abigail Assor ou encore Hajar Azell, deux primo-romancières publiées en 2021, on ne peut que se réjouir de la naissance de jeunes plumes féminines marocaines. Elles ont des histoires à raconter et, à défaut de les apprécier, il faut au moins les lire, car on a trop souvent parlé à leur place.




