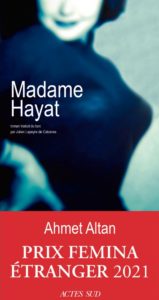 A la mort de son père, Fazıl, ruiné, s’installe dans une pension décatie partagée par des personnages précarisés et, en parallèle de ses études de lettres, travaille comme figurant pour une émission de télévision. Dans ce lieu de décors et de lumières, il rencontre deux femmes dont il tombe amoureux : Madame Hayat, une femme d’âge mûr et profondément libre, et Sıla, étudiante elle aussi en littérature, issue d’une famille aisée dont les biens ont été saisis arbitrairement.
A la mort de son père, Fazıl, ruiné, s’installe dans une pension décatie partagée par des personnages précarisés et, en parallèle de ses études de lettres, travaille comme figurant pour une émission de télévision. Dans ce lieu de décors et de lumières, il rencontre deux femmes dont il tombe amoureux : Madame Hayat, une femme d’âge mûr et profondément libre, et Sıla, étudiante elle aussi en littérature, issue d’une famille aisée dont les biens ont été saisis arbitrairement.
Alors qu’au dehors sévissent les hommes aux bâtons, traquant le moindre écart à leur vision de la religion, et un pouvoir de plus en plus répressif, Fazıl découvre deux façons de vivre et d’aimer. Et il les vit intensément.
Carpe diem
Ahmet Altan a écrit ce livre magnifique en prison, où il a passé près de cinq ans, alors qu’il avait été condamné à perpétuité, accusé d’avoir participé au coup d’État manqué de 2016, avant que sa condamnation ne soit cassée. Le roman, qui ne cite pas la Turquie, pourrait se passer dans tout pays autoritaire où l’arbitraire règne, où les voix critiques sont poursuivies, où “la vie des gens (change) en une nuit” et où la devise est “Désormais, interdit de blaguer”.
“On aurait dit que nous étions coincés dans la paume d’un géant qui pouvait nous écraser quand il le voulait, d’un seul geste, en refermant la main.” Mais cette violence n’est que la toile de fond. Comme Mohamed Leftah situant la beauté dans les bas-fonds, c’est aux marges que s’intéresse l’auteur, c’est là que se trouvent ses personnages les plus profonds, les plus épris de liberté.
“Quand on a de l’argent, on le dépense, quand on n’en a pas, on s’en passe”
À la pension, il y a Gülsum le travesti, qui n’en finit pas d’être battu et violé, le Poète, journaliste critique et terriblement lucide, un père élevant seul sa fille. À l’université, dernier refuge de la pensée critique, la flamboyante Madame Nermin se bat face à la police. Et dans les sous-sols de la télévision, dans la chambre d’étudiant, dans la lumière d’ambre de chez Madame Hayat, c’est le lieu de la danse, de la sensualité et des étreintes passionnées.
Comme chez Orwell, l’amour est la seule liberté irréductible. Fazıl la savoure doublement, sans trop s’en vouloir de ne pas choisir entre le volontarisme de Sıla et la nonchalance de Madame Hayat, entre l’attitude rationnelle de l’une et les maximes lapidaires de l’autre : “Quand on a de l’argent, on le dépense, quand on n’en a pas, on s’en passe” ou “Je n’aime pas la peur, elle m’ennuie”.
Madame Hayat, de son vrai nom Nurhayat, la lumière de la vie, confie : “Je ne sais pas prendre de grandes décisions, seulement des petites. Les petites décisions me rendent heureuse.” L’ultime sagesse dans un univers d’oppression.
Dans le texte.
Le goût du miel
“J’en sais bien plus long que tu n’imagines sur la vie et ses réalités, comme tu dis. Je sais ce que c’est que la pauvreté, la mort, le chagrin, le désespoir. Je sais que nous vivons sur une planète où des fleurs graciles dévorent les insectes qui se posent sur elles. Je sais que depuis des milliers d’années les hommes se font du mal, qu’ils volent et en spolient d’autres, qu’ils s’entretuent. Je connais réellement la vie. Et comme tout le monde, je mange son miel empoisonné. Le poison je l’avale, le miel je le savoure. Tu peux gémir autant que tu veux, tu peux redouter autant que tu veux ce miel empoisonné, ni la peur ni les gémissements ne détruiront le poison. Tu ne réussiras qu’à tuer le goût du miel. Les réalités de l’existence, je les connais, seulement je ne m’y arrête pas. S’il faut boire le poison je le bois, mais les conséquences ne m’intéressent pas. Parce que je sais qu’enfin il s’agit de mourir…”




