78.000. C’est le nombre d’ouvriers marocains qui ont été recrutés par la France pour travailler dans des mines, dans les années 1980.
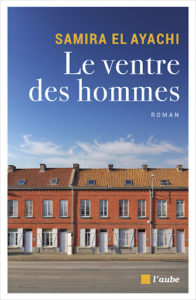
355, c’est le nombre de pages que Samira El Ayachi noircit pour raconter leur histoire, dans son dernier roman, tout juste paru aux éditions de l’Aube, Le ventre des hommes.
L’héroïne, Hannah (lire Hanae) est la fille de Mohamed Katib, qui avait quitté Zagora, sa ville natale, en raison de la sècheresse. Ses terres devenues stériles, il a été recruté par les Houillères à Lens, dans le Nord-Pas de Calais, pour travailler dans les mines. Après une démarche de regroupement familial, sa femme et ses enfants le rejoignent en France, où naît Hannah, dont le parcours est particulièrement similaire à celui de Samira El Ayachi.
Au cœur des mineurs
“Je ne sais pas trop quoi vous dire”, répond d’emblée Samira El Ayachi, confrontée à l’exercice du portrait. Bien qu’elle en soit à son quatrième roman, on croirait, à sa modestie, qu’elle nous parle du tout premier. “Je suis née à Lille, mais j’ai toujours conservé un lien particulier avec le Maroc”, indique-t-elle.
Mais si ses deux parents sont marocains, plus précisément natifs de Zagora, Samira El Ayachi ne perçoit pas son pays d’origine comme une destination de vacances en famille : “C’est là que j’aime venir pour écrire. D’ailleurs, une grande partie du Ventre des Hommes a été écrite à Tanger”.
Après le succès qu’a connu Les femmes sont occupées il y a deux ans, Le ventre des hommes semble être son roman le plus intime. Elle y explore une relation père-fille ambivalente, marquée par un surplus d’amour qui ne peut qu’être poignant, tout en restituant l’histoire des ouvriers marocains, qu’elle refuse de qualifier “d’immigrés”, parlant plutôt “d’exilés climatiques”.
“On a trop souvent tendance à oublier que ces hommes ont connu un déclassement social lorsqu’ils sont arrivés en France. Beaucoup ont fui leurs terres à cause de la sècheresse, afin de pouvoir continuer à nourrir leurs familles”, tient à rappeler l’autrice.
“Tous mes livres font le lien entre l’intime et des questions de société qui me touchent”
“Je dirais que tous mes livres font le lien entre l’intime et des questions de société qui me touchent particulièrement. J’aime voir comment ces deux dimensions peuvent se répondre. Je dirais tout de même que celui-ci est beaucoup plus proche d’une histoire familiale. Une histoire dont je suis issue. Cela fait dix ans que je porte ce roman”, poursuit-elle.

Pour l’écrire, elle a arboré une casquette de journaliste, allant à la rencontre de dizaines de familles de mineurs marocains et fouillant méticuleusement les archives. “C’était une histoire que je ne connaissais pas réellement moi-même lorsque j’ai commencé à l’écrire”, confie l’autrice.
Abordant aujourd’hui la quarantaine, Samira El Ayachi a décidé, il y a près de dix ans, de se consacrer pleinement à sa carrière de romancière. Son écriture est rythmée, douce et tranchante. Dans Le ventre des hommes, l’enfance suit chaque mot, chaque tournure de phrase. Car Hannah est un personnage qui, une fois devenue adulte, œuvre à préserver l’innocence de l’enfance, à ses risques et périls.
Par d’incessants allers-retours, Samira El Ayachi nous fait voyager entre les années 1980-1990, le début des années 2000, et l’année 2016, marquée par les conséquences des attentats du 13 novembre en France. Rien n’est chronologique, car c’est à travers le brouillon des souvenirs restitués par Hannah dans le commissariat de police où elle est interrogée que se dessine l’histoire des ouvriers mineurs maghrébins.
Samira El Ayachi maîtrise sa narration : dès les premières pages du roman, on apprend que Hannah a commis un crime. D’une plume remarquable, elle tient son lecteur en haleine tout au long du roman, car la nature de ce crime, dit “grave”, “inadmissible”, “dangereux”, ne sera dévoilé qu’à la fin de l’histoire. C’est que le passé justifie le présent, et que son acte, aussi inquiétant qu’il puisse être, n’est pas aussi important que les raisons qui l’ont poussée à le commettre, et dans la foulée, à refuser le système établi.
La langue des autres, la TV des nôtres
L’enfance de Hannah se déroule dans les “maisons des mineurs” : des logements précaires et insalubres, mis à disposition des familles des ouvriers qui travaillent dans les mines, au péril de leur santé. Petite fille, elle voit son père tousser, subir des examens médicaux.
Pourtant, Samira El Ayachi fait le choix de ne pas raconter une enfance sombre et morbide. Celle-ci est pleine de vie, de rires et de douceur. “S’il y a quelque chose de plus dur que de vivre la misère, c’est d’être vu et désigné comme misérable par les autres”, explique-t-elle.
“Le souvenir de l’enfance apporte beaucoup de lumière. L’enfance est créative, dans n’importe quelles circonstances, l’enfance réinvente toujours. Elle est une sorte de géographie, que l’on peut invoquer à tout moment, et qui est en mesure de tracer des horizons”, poursuit-elle.
Très vite, on comprend entre les lignes que Hannah, munie d’un gros dictionnaire dont elle ne se défait jamais, cherche le sens de la vie, de ses douleurs, souffrances et injustices, à travers la définition, la nature et la sémiologie des mots. “Parce que nous sommes des êtres de langage, mais qu’en même temps, nous avons toujours souffert d’un ensemble de malentendus qui causent beaucoup de souffrances et d’injustices”, justifie-t-elle.
Et de préciser: “Je voulais aussi parler du mépris et de la condescendance que l’on peut avoir pour certaines langues”. Faut-il le rappeler, si Hannah ne parle que le français, son père, lui, parle principalement l’arabe. “Tout dépend du point de vue. Peut-être que du point de vue du père, c’est sa fille qui est analphabète, car elle ne parle ni écrit l’arabe littéraire”.
“Lorsqu’on s’exile, on peut laisser beaucoup de choses derrière soi, mais pas sa langue”
Pour Samira El Ayachi, les langues sont “les butins d’une guerre qu’on n’a pas eu à faire”, comme elle l’écrit joliment dans le roman. “Ce que je veux dire par là, c’est que tout ce bassin de langues présentes sur un territoire donné sont le résultat de l’accueil d’un ensemble d’histoires intimes, qui ont conduit à l’exil. Lorsqu’on s’exile, on peut laisser beaucoup de choses derrière soi, mais pas sa langue”.
Elle poursuit : “Une langue, c’est une structure de pensées, et donc, une façon de voir le monde. C’est pour ça qu’une langue nouvelle arrivée sur un territoire sera toujours une richesse. Je pense même que l’on devrait parler d’identités langagières, plutôt que d’identité ethnique”.
La devise de Samira El Ayachi pourrait être la suivante : dis-moi dans quelle langue tu rêves, et je te dirais qui tu es. Pour la petite fille qu’est Hannah, la langue est “une ligne droite coupée par deux perpendiculaires”, l’arabe et le français.
La langue occupe donc une place centrale dans Le ventre des hommes, dont le récit est également truffé de références littéraires, d’Emile Zola à d’anciens poèmes et chansons amazighs regroupées par Aksil Azergui. “Je voulais redonner leur place aux langues maternelles, ces grandes oubliées”, justifie Samira El Ayachi.
Autre élément central : la télévision. Une boîte de Pandore plantée au milieu du salon familial, tantôt amie, tantôt ennemie. Une fenêtre sur la France et l’Amérique, sur un monde glamour plein de strass et paillettes, mais aussi un objet de frustrations, une fenêtre sur les disparités sociales, un reflet du contraste entre l’univers de Hannah, et celui du privilège blanc.
“J’en parle comme une boîte à merveilles, un petit clin d’œil à Ahmed Sefrioui. Pour l’enfant, c’est l’irruption de l’ailleurs, toutes les paillettes dont elle rêve et qui ne lui sont pas accessibles”, explique l’autrice à ce sujet, avant de nuancer : “En grandissant, elle va aussi comprendre que la télévision est le canal par lequel les catastrophes du monde lui parviennent. C’est le moment de la désillusion, du désenchantement”. Une boîte à merveilles, devenue machine infernale, qui contribue à sa manière au crime que commet l’héroïne.

Le goût de la mémoire
Dans l’univers que crée Samira El Ayachi, traversé par les confidences d’une héroïne adolescente puis des tourments et hésitations de la jeune adulte qu’elle devient, le père reste toujours un pilier du récit. La relation qui unit ces deux personnages est ambivalente : en l’espace d’un roman, on passe de l’admiration oedipienne de la fille pour le père, à l’éloignement progressif puis au conflit, la confrontation ultime, l’heure de vérité.
“Je voulais raconter l’amour d’une fille pour son père, une fille d’ouvrier mineur, qui va récupérer un héritage d’indocilité. Je ne sais pas si on peut dire qu’elle venge son père en commettant ce crime, mais en tout cas, il y a un héritage de contestation, de désobéissance, et de lutte pour le droit commun qui est transmis”.
Cet héritage, c’est avant tout celui des ouvriers maghrébins, non pas dociles comme on l’a trop souvent pensé, mais qui se sont battus pour leurs droits (de grève, de se syndiquer), jusqu’à la fermeture définitive des mines.
Si le duo filial est fusionnel, au point que les autres membres de la famille n’ont pas de prénom et sont simplement désignés comme “grande sœur”, “petit frère” ou encore “ma mère”, il est le cœur de la dimension sociale et engagée du roman.
Une attention particulière est aussi accordée au climat social de la période qui a suivi les attentats du 13 novembre 2015 en France. Deux époques que tout sépare sont alors magistralement mises en lien par le biais de la fiction. Lorsque Hannah et son compagnon Nils se séparent, au lendemain des attentats, Samira El Ayachi y voit même une métaphore : “C’est ce qui s’est passé en France à une échelle sociale. Elle veut continuer à avoir foi en les autres. Lui choisit de se renfermer complètement dans une peur de l’autre, lorsqu’il est différent”.
Dans ce roman au goût prononcé pour la véracité historique, Samira El Ayachi ponctue ses chapitres par des documents d’archives, scannés. “Je voulais que le lecteur se fasse une idée de la manière dont les Houillères percevaient les ouvriers qu’ils recrutaient. C’était d’une violence inouïe”, explique-t-elle.
Avant d’ajouter : “C’est une histoire collective qui nous concerne. Je ne l’ai pas écrite pour glorifier le passé de ces hommes, mais pour raconter l’asymétrie très violente entre l’Etat français et ces familles marocaines. J’avais besoin de parler de leur combat mais en l’actualisant, de sorte à montrer que leur héritage est présent dans les gènes de leurs enfants”.
Une chose est sûre : malgré un propos engagé, puissant, Le ventre des hommes refuse catégoriquement de se cantonner à un discours exclusivement social. “Je ne veux pas être réduite à un objet d’étude sociologique. La dimension de la fiction me permet de créer un univers engagé, et c’est comme ça que je deviens actrice de l’histoire collective que j’ai vécue”, confie l’autrice sur la place qu’occupe la fiction dans un texte qui aurait pu être entièrement autobiographique.
Samira El Ayachi réussit ainsi un tour de force : s’écarter des motifs standards du roman de l’immigration en accueillant à bras ouverts la fiction, afin de sublimer le propos social qu’il contient, tout en restant attachée à la véracité de l’histoire et de la mémoire. Un pari gagnant.




